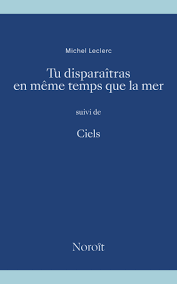
Cher Michel Leclerc,
Ce n’est pas là dans mes habitudes, mais une exigence aujourd’hui m’y pousse. J’écris publiquement une lettre personnelle à un auteur. Les circonstances m’y obligent. Nous vivons à l’échelle planétaire des heures bien sombres, j’en conviens, mais c’est plus petitement que la nuit jette sur nous un quasi-couvercle de cercueil. La littérature, la nôtre, la québécoise, se voit aujourd’hui mise en péril. Les médias se préoccupent peu de poésie. Les journaux lui réservent la part congrue ; revues et magazines vaillamment tentent de tenir le fort, quelques blogues font de même. Mais voilà, il me semble qu’on ne puisse pas se payer le luxe de perdre trop de plumes. Dans le magazine Nuit blanche, durant de nombreuses années, des livres d’ici et d’ailleurs ont été recensés ; de nombreux auteurs ont fait l’objet d’articles étoffés. Mais voilà, le présent est incertain, on ne sait trop si le magazine nous reviendra ou non. Cela est bien dommage.
Comme vous le savez sans doute, il m’est arrivé depuis deux ou trois ans de collaborer très régulièrement à ce magazine. Il permet aux ouvrages qui paraissent d’être commentés très peu de temps après leur arrivée en librairie. Parfois, la recension est contemporaine de la « vie active » du livre, encore en circulation. Eh bien, voilà, si tout était pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles, je parle candidement, le sort que je réserverais à votre livre verrait paraîtrait mon commentaire dans ce magazine dans les plus brefs délais, afin que lecteurs et lectrices soient avertis le plus tôt possible de l’importance de votre livre, de l’intérêt qu’il représente.
En matière de recensions, l’imprimé pèse davantage que le numérique. On peut sans doute lui accorder plus de crédibilité. Mais il faut battre le fer quand il encore chaud et c’est ce que je m’empresse de faire ici, quoique je suis convaincu que votre recueil est là pour durer, que sa vie ne saurait être passagère et qu’on prendra gravement plaisir à le lire pendant encore longtemps, car s’il est appelé un jour à disparaître, ce ne saurait être qu’en même temps que la mer, pas avant. Ah ! Je vous fais sourire. Tant mieux. Et tant qu’à sourire, je veux vous en donner une raison de plus. Sachez que la lettre que je vous écris aujourd’hui aura une suite. Si Nuit blanche, dont l’existence est aujourd’hui mise entre parenthèses, nous revient, j’entends bien soumettre à la rédaction une recension en bonne et due forme dans laquelle je ramasserai de manière plus compacte l’ensemble des propos que je veux ici même tenir. Sinon, je proposerai aux responsables de la revue Possibles un papier similaire. Pour l’heure, voici en gros mes premières impressions de lecture.
Je dis mes premières impressions, à vrai dire, ce sont davantage que des impressions et elles sont loin d’être premières. Je lis votre livre depuis quelque temps déjà. Je l’ai lu à maintes reprises et je le relirai. C’est là, n’est-ce pas, ce que l’on fait lorsqu’on est en présence d’une grande œuvre. Et puisque nous sommes ici entre nous, que nous avons tout notre temps et que les curieux et les curieuses qui liront cette lettre apprécient tout autant que vous et moi ce que l’on appelle une grande œuvre, plongeons-nous dans une des plus pages des Fleurs du mal. Une servante au grand cœur a fait écrire au poète des vers qui ne sont pas sans rapport avec ceux de votre très beau recueil.
LA SERVANTE AU GRAND CŒUR DONT VOUS ÉTIEZ JALOUSE
La servante au grand cœur dont vous étiez jalouse,
Et qui dort son sommeil sous une humble pelouse,
Nous devrions pourtant lui porter quelques fleurs.
Les morts, les pauvres morts, ont de grandes douleurs,
Et quand Octobre souffle, émondeur des vieux arbres,
Son vent mélancolique à l’entour de leurs marbres,
Certe, ils doivent trouver les vivants bien ingrats,
A dormir, comme ils font, chaudement dans leurs draps,
Tandis que, dévorés de noires songeries,
Sans compagnon de lit, sans bonnes causeries,
Vieux squelettes gelés travaillés par le ver,
Ils sentent s’égoutter les neiges de l’hiver
Et le siècle couler, sans qu’amis ni famille
Remplacent les lambeaux qui pendent à leur grille.
Lorsque la bûche siffle et chante, si le soir,
Calme, dans le fauteuil, je la voyais s’asseoir,
Si, par une nuit bleue et froide de décembre,
Je la trouvais tapie en un coin de ma chambre,
Grave, et venant du fond de son lit éternel
Couver l’enfant grandi de son œil maternel,
Que pourrais-je répondre à cette âme pieuse,
Voyant tomber des pleurs de sa paupière creuse ?
La servante est ici l’âme pieuse dans le souvenir de qui se recueille le poète. Le poète nourrissait à son endroit une grande affection. Sa mère à qui il s’adresse ici était moins commode, moins facilement aimable, ce en quoi elle ressemble à la mère que vos poèmes font revivre sous nos yeux. Si je vous fais relire ce poème, bien entendu, c’est que sa thématique n’est pas étrangère à celle qu’on voit à l’œuvre dans les poèmes de Tu disparaîtras en même temps que la mer. C’est aussi, et peut-être surtout, parce que les qualités littéraires de ce recueil ne sont pas sans faire songer à la poésie d’un poète comme Baudelaire. Évidemment, cette parenté ne signifie pas une ressemblance à l’identique. Du temps a passé depuis la parution du recueil de Baudelaire. On ne saurait confondre vos poèmes avec les siens. Cependant, un trait commun demeure, il y a là plus d’un trait commun à vrai dire. Le principal a, je crois, affaire à une éthique du poème, à une conception et une pratique de la littérature où il s’agit d’établir la plus étroite correspondance qui soit entre le verbe et ce que l’on pourrait appeler la chair de sa substance. Je m’explique sans doute mal ; mes mots dans leur approximation laissent filtrer ma pensée, mais ne l’expriment pas de manière assez claire. Permettez-moi de prendre le temps de la développer.
Roger Caillois dans Approches de la poésie voyait à l’œuvre chez Saint-John Perse ce qu’il qualifiait d’image « juste », « irrécusable et qualitative ». Il déplorait qu’en poésie on pût rechercher, jusqu’à l’abus et en s’y complaisant, la production d’« images in-imaginables », en somme tirées par les cheveux, ininterprétables, polysémiques au point d’en perdre toutes véritables significations. Il y a lieu de parler avec Caillois d’un certain classicisme. Je pèse mes mots, mais tiens cependant à rappeler que par classicisme l’on entend toutes de sortes de choses, parfois contradictoires. Tenons-nous-en à Valéry, lequel avançait que le classicisme est un romantisme dompté. Pour ma part, je considère que sans ce puissant romantisme (on entend aussi avec ce terme toutes de sortes de choses, parfois contradictoires), sans ce puissant romantisme, à l’œuvre justement chez un Baudelaire qui a si bien su le dompter, le classicisme n’est qu’un enrobage resserré sur une absence de propos.
Pour en revenir à Caillois, je trouve chez vous des images parfaitement imaginables, tout à fait expressives et en tous points idoines au propos que vous tenez. Ce propos, je devrais ici l’évoquer au bénéfice des lecteurs et lectrices que je convie à notre conversation. Ils le découvriront par eux-mêmes, quoiqu’il me faille tout de même ici en donner un aperçu.
Le « tu » du titre renvoie à votre mère. Décédée quand ? Nous ne le saurons pas. Votre recueil n’est pas un récit, même si par endroits, dans quelques pièces de prose surtout, vous relatez des moments, des événements, par exemple l’enterrement de votre père, l’agonie de votre beau-frère. Eux ne sont pas les personnages principaux de votre recueil, ils s’effacent derrière la présence de votre mère et l’espèce de prière que vous lui adressez. Par espèce de prière, je veux dire bien entendu que par-delà la mort vous vous adressez à elle, secouant à l’occasion ses ossements, ses cendres non sans une certaine violence, qui est celle pourrait-on dire du dévoilement d’une vérité.
La vérité, c’est que votre mère n’était pas une femme facile, qu’il a fallu qu’elle meure pour commencer à être véritablement votre mère. Une mère en retard sur sa maternité. Une maternité qu’elle devra finalement à une ultime réconciliation : « J’étais ton fils dès ma naissance / tu fus ma mère le jour de ta mort. » C’est là le début du deuxième poème. À dire vrai, ce n’est qu’au terme du deuil, en tout cas seulement vers la toute fin du recueil (je ne parle pas ici de Ciels, la deuxième partie de l’ouvrage) que le fils sera parvenu à faire la paix en son âme. Sa parole intérieure, fêlée, sa pensée tout aussi troublée, ne connaîtront d’apaisement qu’en traversant l’épreuve des souvenirs ressassés et grâce aux discours adressés à l’absente.
Dans l’article que je désire éventuellement consacrer à votre recueil, je devrai prendre le temps de m’arrêter à la souffrance de votre mère. Sa dureté comme une carapace se refermait sur une profonde sensibilité, sur des blessures intimes tenues secrètes. Je ne sais pas si vous avez déjà vu le chef-d’œuvre qu’a signé il y a longtemps de cela Michel Ocelot. Tiens ! Un autre Michel. Il s’agit d’un long métrage d’animation inspiré d’un conte africain. Il s’intitule Kirikou et la sorcière. Cette sorcière, très belle, est d’une incroyable méchanceté. Elle se montre impitoyable à l’endroit de son peuple. Sous le joug de cette reine, tous vivent des heures misérables. Pourquoi s’arrêter ici à cette sorcière ? C’est en raison de sa souffrance. Le petit Kirikou réalisera un exploit. Il parviendra à contourner tous les obstacles, gens armés défendant l’accès à cette reine maléfique, pour s’en approcher et lui retirer une épine qu’elle a dans le dos et qui, si mon souvenir est bon, la fait terriblement souffrir ou en tout cas est source de la haine viscérale qu’elle réserve à l’ensemble de ses sujets.
Une telle épine se trouvait à mon avis chez votre mère. Il aura fallu que vous parveniez à la lui retirer, en retirant celle qui en votre for intérieur sévissait et vous interdisait d’accéder enfin à l’amour maternel. Quoiqu’il en soit, l’amour, torturé dans les premières pages, apaisé dans les dernières, est partout présent dans la première suite de votre livre. On lui doit des pages touchantes, déchirantes, lyriques, fort émouvantes. L’amour n’y meurt jamais : « ta mort a tout emporté, hormis ce qui ne meurt jamais. Ne subsiste qu’un frémissement. Tu flottes dans ma mémoire comme un second tombeau où je te tiens compagnie, sans connaître l’insensé trépas. »
En terminant, après en avoir sommairement évoqué la substance, je veux revenir à ce qu’on pourrait appeler des questions de métier, ce fameux métier où l’on remet sans cesse son ouvrage. On parle ici de l’art de tisser les mots, de telle sorte qu’ils puissent résonner en parfaite concordance avec ce qui anime le poète, avec ce qu’il cherche à dire. La forme d’un ouvrage est « parfaite » quand elle est faite sur mesure, servant le propos et le rendant à l’exactitude de ses sens. Mon cher ami, vous n’êtes pas un puriste, un parnassien éblouissant revêtant de splendeurs superfétatoires une absence de propos. On vous voit ici habité par le sentiment et l’idée, œuvrant à même le langage afin de découvrir en l’inventant, de réaliser en l’extrayant de votre âme et de votre esprit, le poème qui au plus près exprime tout cela qui vous hante et vous agite.
Le mot sur votre page ne se déploie pas, évanescent, avec la légèreté d’un pétale que le vent de l’inspiration y déposerait gratuitement de manière hasardeuse. Il y a plutôt chez vous une certaine vitalité, une gravité de sens qui le plombe, faisant peser le mot de tout son poids de sens sur la compréhension qu’en a presque immédiatement le lecteur. Chez vous, tout s’accorde, tout concorde avec la gravité du sujet. Si l’on admire la qualité intrinsèque de vos poèmes, il faudrait mettre qualité au pluriel, si nous éblouissent ces qualités formelles, c’est en grande partie parce qu’elles n’éclipsent en rien votre propos, propos qu’au contraire elles magnifient.
J’aurais encore bien d’autres choses à dire au sujet de votre recueil. Je les dirai en temps et lieu. Pour l’heure, mon intention était d’annoncer aux lecteurs et lectrices de mon blogue la parution de votre dernier livre. On le trouve actuellement en librairie ; je crois venu le temps de s’y précipiter. Votre livre fait partie de la petite poignée d’ouvrages que contiendra ma valise si un jour je décide d’aller voir ailleurs si j’y suis. Blague. Il faut bien rire. Il faut surtout impérativement lire votre dernier recueil.

Très hâte de lire le tout dernier opus de Michel Leclerc.
J’aimeJ’aime
Vous l’aimerez, je n’en doute pas une seconde. Bonne lecture !
J’aimeAimé par 1 personne
Nous avons très hâte de lire votre recension soit dans Nuit blanche soit dans Possibles.
Merci de cette lettre.
J’aimeJ’aime
Merci, amie Adammonique.
J’aimeJ’aime
« On vous voit ici habité par le sentiment et l’idée, œuvrant à même le langage afin de découvrir en l’inventant, de réaliser en l’extrayant de votre âme et de votre esprit, le poème qui au plus près exprime tout cela qui vous hante et vous agite. »
Oh, et hâte de plonger dans cet ouvrage, cher Daniel! ✨❣️
J’aimeJ’aime
Que de belles choses à lire !!!
J’aimeAimé par 1 personne
Les fragments de poèmes de Michel Leclerc enrichis de ta description du conte de Michel Ocelot Kirikou et la sorcière démontrent à quel point la poésie peut être une surprenante et puissante alliée de la psychothérapie!
J’aimeJ’aime
En ce jour de la fête des mères, tu as lu un commentaire portant sur un livre consacré à une mère. Oui, tu as raison, la poésie entretient des rapports étroits avec la psyché. Freud et toute la psychanalyse avec lui puise abondamment dans l’imaginaire des arts et des lettres.
J’aimeJ’aime