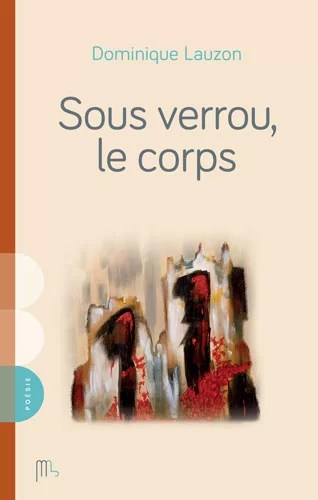
Un humble et solide artisan de l’édition et du monde littéraire peut cacher un excellent poète. Dominique Lauzon travaille depuis toujours dans le milieu du livre. Le sait-on ? La notice qui ferme son dernier recueil fait mention de ses diverses activités d’homme de lettres. À la fin de ses études universitaires, le poète occupe divers emplois. Il enseigne, puis est libraire, correcteur d’épreuves entre autres au Journal de Montréal. Il devient ensuite rédacteur, correcteur et représentant aux ventes pour les Écrits des Forges. Et comme si cela ne suffisait pas, il est également adjoint à l’administration de la revue Exit. Ses activités en tant qu’auteur sont tout aussi diversifiées : collaboration depuis plus de cinquante ans à diverses revues d’ici et d’ailleurs, lectures publiques, publication de plus d’une dizaine de recueils de poésie, dont certains ont été traduits en espagnol, en anglais et en roumain. On le voit, l’écrivain n’a pas chômé.
La note biographique fait par ailleurs mention de ses origines modestes. « Né en 1951 à Montréal, dans un milieu canadien-français ouvrier et catholique, Dominique Lauzon s’intéresse à l’histoire et à la sociologie du Québec. » Ces informations sont tout sauf anodines. Elles éclairent le recueil, offrent en quelque sorte une clef de lecture. L’époque à laquelle nous naissons, le milieu où se déroule notre enfance, en effet, rien de cela n’est innocent, qui aura des répercussions sur le reste de notre existence. Dans le petit monde de Dominique Lauzon, le Québec de la grande noirceur aura pris beaucoup de temps à s’évanouir. La main de la religion catholique pèse fort sur certaines familles — dont la sienne—, les maintenant sous son joug, son emprise. Afin de libérer les âmes, les autorités religieuses croient qu’il faut mettre le corps en cage, sous le verrou.
Le regard perçant d’un sociologue peut analyser objectivement les ramifications, les racines du mal être généralisé affectant une société donnée. Il peut, par exemple, rendre compte de manière un tant soit peu objective du « milieu canadien-français ouvrier et catholique » qui a vu naître notre auteur. Dominique Lauzon procède différemment. Et ce n’est pas d’abord et avant tout à l’aventure collective et aux conditions de vie des siens qu’il s’intéresse. Il recourt au registre poétique, aux ressources qu’offre le poème pour plonger en ses propres abysses et sonde avec sa propre subjectivité les tenants et aboutissants de sa propre histoire. Celle-ci est singulière, on le verra, mais l’on peut déplorer que d’autres aient aussi eu le malheur de vivre à la même époque ce qu’a vécu le poète. Et d’autres aujourd’hui le connaissent encore et toujours : « l’ère préfère / l’eau de rose aux anciennes noirceurs // mais qu’y a-t-il de changé ».
Mais de quoi au juste parlons-nous ? Et peut-on en parler librement ? Peut-on parler librement avant, pendant, et après que le corps a été verrouillé, cadenassé, enfermé dans l’enfer d’une geôle psychique et religieuse, condamné au silence, écrasé par une lourde chape d’interdits, d’hypocrisie et de complicité aveugle ?
L’éditeur sur la quatrième de couverture n’aurait pas pu mieux dire. Je le cite. « Il arrive qu’un écrivain doive produire une douzaine de livres avant de parvenir à celui qu’il cherchait à écrire depuis le début, qui était nécessaire et dont l’urgence était toujours ressentie au fond de lui. Mais il fallait les bons outils et le bon canal pour l’écrire. Eh bien, c’est assurément le cas pour ce nouveau recueil de Dominique Luzon. Avec, Sous verrou, le corps, l’auteur nous livre des textes puissants, au contenu exigeant, qui ne peuvent laisser personne indifférent. »
Il faut beaucoup de silence en amont pour qu’un tel livre puisse être écrit. Beaucoup de silence, strident comme un cri retenu, violent comme des cris retenus, pour qu’on en vienne enfin à extirper de soi des secrets, comme extraits de ses propres entrailles. On délivre certaines vérités comme on donne naissance à un monstre. Un monstre qui ne sommeillait pas dans les entrailles, qui veillait sans arrêt, nuit et jour, cauchemars constants, tassés au fond de soi, prêts à resurgir en tout temps, alors qu’on voudrait faire comme si de rien n’était … mais se taire ne dure qu’un temps. La digue doit finir par céder.
Mais, lisons plutôt le recueil. Nous constaterons que c’est avec une certaine lenteur que le dévoilement de l’horreur s’y accomplit, car ce qu’on n’a pas pu dire, on ne peut pas immédiatement l’exprimer, cracher comme on dit le morceau. Le chat maigre, aux côtes saillantes, ne peut pas sortir du sac en dansant et en riant ; il n’a pas le bonheur facile et ses miaulements sont des plaintes déchirantes.
Mais, lisons plutôt le recueil. Oui, à petites doses, alors que dès les premières pages il est clair que le poète ne nous invite pas à une partie de plaisir ; à petites doses, peu à peu, un climat s’installe ; de manière allusive, évocatrice, le poète dresse un sombre tableau, semble annoncer une catastrophe, non à venir, mais passée, catastrophe d’hier qu’il ramènera à l’avant-plan.
Oui, même dès le titre, nous en prenons acte, une scène de torture est au centre de cette histoire. Et, oui, il y a bel et bien ici une histoire, un récit. Dominique Lauzon va nous raconter une histoire, celle d’un corps empêché. Nous rencontrerons avant la fin du livre un « renard emprisonné dans sa tanière ». Le corps est mis en cage. Le texte liminaire, un bref poème de cinq vers, ne laisse planer aucun doute sur la nature de cette histoire. Le lexique en témoigne où l’on retrouve les mots suivants, « délit », « rage », « cruauté », « clouée » et « choc ». Nous en sommes avertis, nous ne rirons pas en lisant ce livre. Et quand l’auteur ricanera, son rire sera ironique, un rire sous cape, accusateur, un rire planté comme une lame affûtée dans le corps du bourreau.
Les vers qu’on peut lire dans ce recueil ne font pas dans la dentelle. Ce sont des vers puissamment expressifs, dont la beauté souvent a trait comme ici au désarroi d’une âme errante : « embrouillé dans les dédales de sa démarche / un homme fait les cent pas à l’ombre de lui-même ». Ces vers expriment un certain abaissement de l’être ; le voici réduit à n’être rien moins que l’ombre de lui-même. À côté de son double, un double négatif, un fantôme, une manière de revenant, de hantise, de rappel de ce qui fut, du verrou.
Que s’est-il passé ? Au juste, qu’est-il donc arrivé ? Certes, pour le savoir, nous ne pourrons pas tirer les vers du nez des principaux témoins de ce qui s’est alors joué autour d’un certain matin d’avril. Personne ne nous dira ce qui exactement a eu lieu. Assurément, cela était loin d’être un jeu. Il y avait «papa maman », mais eux étaient « occupés à faire semblant / de ne pas remarquer dans la chair / l’éclisse d’un nom à peine prononcé / telle une offense à leur moralité lisse ». Ils reviennent tout au long du récit, car, oui, je le répète, il y a ici un récit, mais c’est un récit qui procède par bonds, ellipses et fragments disséminés à la manière de ces indices que laisse derrière lui un Petit Poucet. Je dis un Petit Poucet parce que la victime était jeune. Et une fois parvenue à l’âge adulte, cette victime reste prise dans les rets du drame qui s’est joué, mais ce n’était pas un jeu ; elle est toujours et encore prise « dans le corset », dans l’étouffoir, dans l’étau dont elle cherche à s’arracher ; mais les mots, il lui faudra les mots pour le dire, pour le crier enfin.
Mais, lisons plutôt le texte. Il nous apprend que, dès son plus jeune âge, l’enfant songe justement au pouvoir des mots « pour atteindre au vivant ». Sous les regards répressifs des bien-pensants, il s’adonne au « vertige adolescent du dire ».
Dans cette histoire, « papa maman » jouent un rôle important, mais je le répète, ce n’est pas un jeu. Le poète raconte l’histoire. Dans son récit, ils apparaissent à au moins dix reprises. Ils ne jouent pas le bon rôle. On l’a vu, ils font semblant de ne pas voir. Ils ne veulent rien savoir, rien d’autre que la blancheur des hosties, rien d’autre que le bleu du ciel à la fin de leurs jours, rien d’autre que ce que révèlent les Évangiles.
papa maman nourris d’Église empesés
de sa morale vont prier en toute humilité
baissent les yeux
que l’enfer s’arrête à la porte
Non seulement ne veulent-ils rien voir, rien savoir, ils ne veulent surtout rien entendre, se bouchent les oreilles quand le fils tente de leur apprendre ce qu’il lui arrive.
jeune homme sidéré
victime en train de suffoquer
dans les miasmes de la calomnie
confronte papa maman
la transparence de leurs regards
t’incrimine à tort
À leur silence, alors qu’ils auront été confrontés à l’horrible « accident », répondront des « mots béliers lancés / contre les murs porteurs de deuil ». L’enfant les condamnera : « par le feu du langage / brûlez maintenant ». L’esprit de vengeance était inéluctable ; la vengeance, pour ne pas dire la haine, couvait sous l’épais manteau du silence, de ce silence que la victime a longtemps redoublé, prolongé.
Ce livre témoigne d’une force reconquise. Son écriture a rendu possible un retournement, une manière de victoire finale sur soi et les événements qui ont sali la victime. Sa poésie est percutante, frontale. Il y a ici une collision, un heurt, un choc. C’est une confrontation rendue possible grâce au poème. Que « papa maman » l’entendent ou non, alors qu’ils ne sont sans doute plus de ce monde, cela importe peu. Le livre est écrit, le silence est rompu, les choses sont dites, et cela en soi est une libération.
Mais dire les choses, longtemps après, et même dans ce livre, cela ne se fait pas d’un bloc, d’un seul trait, d’une seule coulée d’encre. L’auteur procède par étapes, commence par dire en ne disant pas, quasi de manière euphémique, se contentant de poser comme je l’ai laissé entendre des miettes d’information. Il procède par de légères incisions dans la plaie vive du silence. Il exprime un « vif agacement du muet devant l’hécatombe » ; au départ et pendant longtemps, il aura été ce muet. Ce vers, quelques pages plus loin, le poète le répète : « dire / entendre / écouter // puis-je parler limites // agacement du muet devant l’hécatombe ».
De toute évidence, dire l’horreur, celle que l’on a soi-même subie, surtout dans le cadre de la grande et étouffante « Morale » catholique ambiante et familiale, dire n’est pas facile quand la parole inévitablement, pour dire la « vérité […] nue [retournera] la lame / contre le bourreau ».
Dire est difficile, mais contenir éternellement un bouillonnement intérieur l’est tout autant. Même tardivement, l’heure de la délivrance doit sonner, surtout quand « une unique couture / retient à l’intérieur un raz-de-marée ». Vient un temps où il n’y a « plus de digue » qui tienne. Les « mots / accumulés au mur des lèvres / et jamais sortis » font alors irruption. Le volcan contenu est en éruption. Le non-dit est dit.
Mais exactement, précisément, que s’est-il passé ? Le poète donnera des bribes d’informations, livrera ici et là des éléments concrets relatifs à son histoire, fragments, bribes, morceaux de ce qui a volé en éclat, s’est cassé lors de l’événement, comme la vitre d’une voiture accidentée. Chose certaine, il y a eu un accident. Cet accident consiste-t-il en une métaphore ? Correspond-il à une figure de style exprimant un autre type de collision ? « tu fonces vers la voiture à l’arrêt / au milieu d’une route de feu […] un vide abyssal / emporte le conducteur ». Tout cela est troublant, qui se mêle à une autre information, relative celle-ci au moment où l’accident s’est produit. On lit ceci quelques pages plus loin : « déambuler parmi les souvenirs / projette l’homme d’avril / au plus près de ses racines / devant l’image d’un tombeau / sur la route d’un été lointain // sous la toile silencieuse / les yeux d’un mort // le conducteur de la voiture accidentée / lui fait signe l’invite croit-il / à s’évader avec lui ». Une date sera précisée : « un matin d’avril mille neuf cent quatre-vingt-six ». Nous n’en saurons pas davantage. Mais il nous sera possible de rattacher entre elles les informations qui nous sont livrées. Ainsi, en de multiples passages est-il fait référence à ce qui est sale ainsi qu’à la nécessité de se laver. N’allons pas croire que le poète tente de dissimuler quoique ce soit — le chat maigre et sale sortira bel et bien du sac —, mais c’est plutôt moi ici qui cherche à ne pas tout dire, me refusant à prendre le relais du poète, à lâcher, à cracher ce morceau que lui dissémine un peu partout dans son livre et qui à plus d’une reprise dit les choses telles qu’elles se sont produites. C’est lui et non moi qui prononce le mot, qui explicite en quoi victime il y eut et de quel mal précisément elle a eu à souffrir.
Mots volcans
garrochés aux bourreaux
par tous les enfants
que Jésus a laissés venir à Lui

👍🏿
Envoyé de Yahoo Courriel pour iPhone
J’aimeJ’aime