
Ce tout premier recueil réserve d’agréables surprises. C’est le premier recueil de poèmes de l’écrivaine, mais ce n’est pas son premier livre. Elle écrit depuis toujours. Des poèmes, des contes, des nouvelles et aussi des essais. Par ailleurs, elle possède une solide formation universitaire. Elle compte plusieurs publications à son actif, à L’Harmattan, aux Presses de l’Université du Québec, ainsi qu’en autoédition.
D’une docteure en sémiotique, on pourrait s’attendre à lire des poèmes savants, abstraits, voire hermétiques. Certes, si c’était le cas, on n’aurait là rien à redire. C’est un truisme, mais nul n’ignore qu’il y a place pour presque tout dans le vaste monde de la poésie. Or, dans ce tout fort diversifié, la poésie de Louise Boisclair fait plutôt bande à part. La poète se tenant à l’écart de tout courant ou presque. Son originalité vient sans doute de ce qu’elle ne cherche pas à produire de l’inouï, de l’inédit. Tout en se montrant inventive, elle n’hésite pas à puiser dans ce que la tradition met à la disposition de tous et de chacune. Bien que faisant part d’une certaine maîtrise, la forme chez elle ne révolutionne nullement le discours poétique : ses vers ne rompent pas avec la pratique usuelle ; ils sont libres, un point c’est tout. Sa poésie ne surprend pas davantage, elle dit de la manière la plus claire qui soit des choses plutôt essentielles, des choses graves. En un mot, rarement ou jamais ne se demande-t-on de quoi il est question dans ses poèmes. Leurs référents ne nous échappent pas. Leur propos est intelligible et j’ajoute fort pertinent. Cela fait de ce recueil une rareté.
Ça pleurait sans le savoir. Le titre est intrigant. Il faut lire l’ensemble du recueil pour en saisir la portée. Il ne signifie pas que l’ignorance confine au malheur. Il n’est donc pas question ici du savoir en tant que tel, des connaissances qu’un être emmagasine au fil de son existence afin de se construire et de reconstruire son rapport au monde. Il est plutôt question d’une souffrance in-sue, dont l’être ignore tout, d’une souffrance accomplissant ses ravages au cœur de l’être, tout au fond de son âme obscurcie, souffrance enfouie profondément dans son inconscient. La descente aux enfers seule rend possible une éventuelle reconstruction.
Louise Boisclair trace ici un parcours de libération. Mais avant de voler de ses propres ailes, l’oiseau devra se libérer des rets que lui a tendus sa propre existence. Ce qui est antérieur à l’atteinte de cet apex fait l’objet des poèmes que nous lisons ici. Sans jamais entrer dans les détails du drame, la poète esquisse un monde trouble, lequel est à la fois le sien et celui d’une plus vaste communauté.
C’est dans la première partie du recueil (« Durs durs les mondes violentés ») que la poète prend en compte la misère de l’humanité, notamment celle des opprimés. Cette partie offre de saisissants tableaux. La poète excelle à représenter les rudes conditions auxquelles sont confrontés entre autres les migrants, les populations déplacées, en mouvement quasi perpétuel, fuyant leur coin de pays afin d’aller vivre sous des cieux plus cléments. Les premiers poèmes évoquent les fléaux subis par ces laissés-pour-compte : « les absurdités de la guerre », la crise climatique, les ennuis de santé. Tout est ici saisissant de réalisme.
La poète donne à voir des êtres qui ne sont pas des personnages de papier. Sans représenter dans le moindre détail les pauvres malheureux qui pullulent dans les tableaux qu’elle brosse, la poète parvient en peu de mots à étoffer ses descriptions, à densifier son propos : « Après les secousses / expectorant la guerre / des femmes hommes enfants / découvrent le carnage / foulent les ruines de leur vie ». Arrivent bientôt « des soignants et secouristes ». Ils « ligaturent désinfectent suturent / des civières de déchirures ».
La ligne poétique de Louise Boisclair est solide tout en étant tenue, je veux dire nullement chargée d’épithètes ou d’adverbes. Cette relative simplicité va de pair avec un expressionnisme verbal dont la sobriété n’est pas étrangère au fait que lecteurs et lectrices sont ainsi directement interpellés par le propos des poèmes. Rien ne vient brouiller leur entendement. Mais, objectera-t-on, en quoi peut-on parler de poésie quand une langue est si claire ? Quand le poème, malgré le vers, s’apparente à ce point à la prose ? Où est le poétique dans ce qui suit ? D’abord le contexte : nous sommes en présence d’une mère fortement éprouvée, elle « se lamente / les seins asséchés ». On parle dans le poème de maltraitance ou en tout cas d’incapacité à prendre correctement soin d’un enfant : « les services sociaux / emmènent le nouveau-né / en lieu sûr ».
Où est la poésie ? La question se pose, mais elle est sans intérêt puisque le texte remplit tout à fait son mandat : il expose à notre vue une réalité mieux que ne le ferait un langage contourné, alambiqué, avec lequel la poésie est trop souvent confondue. Le travail de Louise Boisclair est plus fin. D’un raffinement qui se situe dans la précision langagière et non la préciosité. Il met en place des dispositifs textuels efficaces. Si bien que ce qui se donne à lire comme simple description de la réalité, disons la scène suivante : une embarcation en haute mer, emplie de miséreux que la poète n’évoque pas, qu’elle ne montre pas. Elle se borne tout simplement à mentionner que « la noirceur a avalé la côte ». Elle évoque un prochain débarquement. L’attente comble « les heures de surplace ». Tout cela représente une réalité très concrète. Or ce poème peut être lu à un autre niveau, et s’avérer une allégorie de la situation commune à tout être humain qui se projette dans l’avenir, imaginant des jours meilleurs, des « ailleurs ».
La palette de l’artiste est riche. D’une section du livre à l’autre, le style se transforme et, bien qu’une grande unité soit la marque de ce recueil, le propos lui-même fait l’objet de maintes variations. Tout à fait différents des premiers poèmes, on peut lire des poèmes dialogués au milieu du recueil, précisément dans la troisième section, celle qui donne son titre au recueil. Ces poèmes ancrent encore plus profondément le discours poétique dans le monde réel. Leur caractère oral contribue à renforcer le lien que la poète tisse avec le monde réel. Tous les poèmes de cette partie ne se présentent pas sous la forme dialoguée ; il n’empêche, leur simplicité a aussi quelque chose qui tient de l’oralité, de la parole recueillie au plus près de l’être. Je ne peux m’empêcher de citer un poème in extenso. Ce n’est pas le plus important poème du recueil, mais il donne une idée assez juste de l’ensemble du recueil. J’en citerais volontiers plusieurs autres dont j’apprécie la prégnance, la nécessité.
Quand il n’était pas là
on se demandait où il était
ce qu’il faisait pourquoi il n’était pas
où nous l’attentions
quand enfin il arrivait
plus ou moins ivre
il titubait vers la chambre
cuver ses impensés
éructer son trop-plein
il n’était pas là
quand il était là
à jeun, sans alcool
aucun mot ne sortait
de sa bouche muselée
le regard fuyant
il mangeait à table
perdu en lui-même
devant nos questions
derrière son cœur
troué gêné troublé
il était ailleurs
là ou pas
il n’était pas là.
Comme on le constate ici, la poète a l’excellente idée de terminer son poème avec un point. Tous ses poèmes se terminent ainsi, cela élimine de possibles ambiguïtés. Dans certains ouvrages de poésie, il arrive que nul procédé n’intervienne afin de rendre distincts les uns des autres les différents poèmes. Si un tel effet de continuité peut être recherché, il risque néanmoins d’embrouiller le discours.
J’évoquais au début de ce billet un parcours, une trajectoire. Toute une vie ici est résumée, à la manière d’un bilan à la fois personnel et impersonnel. L’auteure ne confie rien d’elle-même sinon au moyen du filigrane. Elle est à la fois présente et absente de son recueil, s’effaçant souvent derrière ses personnages, dont certains sont à coup sûr des personnes que très certainement elle a côtoyées de près, parfois de trop près —songeons à cet ivrogne trop bien dépeint pour ne pas être vrai, pour ne pas être directement sorti de la vie réelle de la poète.
Il me semble qu’un verbe décrit la plus profonde pensée de la poète, il s’agit du verbe « subsumer ». Le tout dernier poème du recueil en constitue presque une définition, il dit en tout cas le point d’arrivée, de libération atteint par la poète. Je le cite.
Les revers mondifient le monde
jusqu’au moment où
le Monde et ton monde ne font qu’un.
Grâce à cet ouvrage la poète aura partagé avec les autres son ascension, sa remontée du fond de l’abîme à « l’éveil de la clarté ». Sa propre expérience la rapproche de ceux et celles auxquels elle a consacré la plupart des poèmes de son recueil, sa personne s’inscrivant dans le plus vaste ensemble.
Cette expérience, non pas une expérimentation, non pas un exercice entrepris froidement, il conviendrait d’en parler en termes d’existence. La poète aura utilisé différents mots pour décrire son périple, dont le plus criant est celui de trauma. Des images en donnent la mesure. La poète utilise le champ lexical de la chute, du trou : « impossible de moisir au fond du trou. » Il lui a fallu trouver, quitte à l’inventer, une corde tendue, « la corde de rappel ». Ça pleurait sans le savoir. Il a fallu comprendre pourquoi et trouver le moyen d’accéder à la lumière.
Seul le scalpel
de l’analyse
a pu trancher
les nœuds.
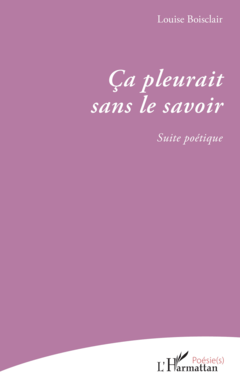

Une réflexion sur « Louise Boisclair : Ça pleurait sans le savoir : Suite poétique : Les Éditions de l’Harmattan : 2024 : 89 pages »