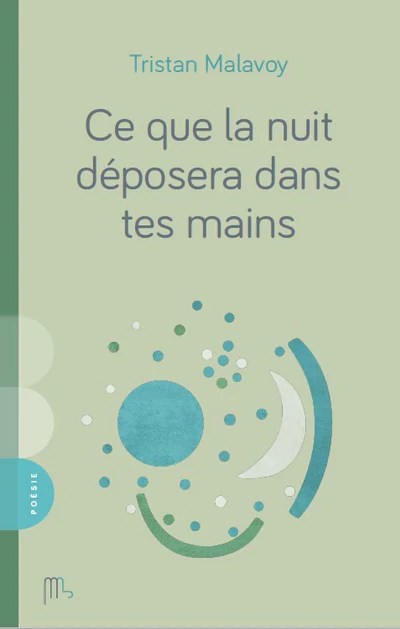
On se souvient de Paul Valéry, de son « Cimetière marin ». Ce long poème contient des vers qui sont parmi les plus beaux de la langue française. Leur énigmatique beauté parvient encore à séduire quantité de lecteurs, dont je suis. Le poète avait été l’émule de Stéphane Mallarmé, poète fréquemment accusé d’hermétisme. C’est avec délices qu’il en avait subi l’influence. À son tour, il était devenu le mentor des nouvelles générations. Durant quelques années, le jeune André Breton l’avait assidûment fréquenté, avait été profondément marqué par ses œuvres et sa pensée ; puis, Breton avait rompu avec le maître afin de prolonger jusque dans le surréalisme naissant les courants qu’en amont Rimbaud et Lautréamont avaient fortement alimentés. La poésie se libérait alors de plus en plus du joug que faisait porter sur elle l’obligation de rimer absolument à quelque chose.
Paul Valéry s’est maintes fois expliqué au sujet de la signification et de l’interprétation des œuvres littéraires et principalement poétiques. Selon lui, « il n’y a pas de vrai sens d’un texte. Pas d’autorité de l’auteur. Une fois publié, un texte est comme un appareil dont chacun peut se servir à sa guise et selon ses moyens : il n’est pas sûr que le constructeur en use mieux qu’un autre. » Cela se trouve dans Variété, dans le texte intitulé « Mémoires du poète ».
Toujours sur la question de la signification des poèmes, on se souviendra de la position de Breton qui affirmait de manière péremptoire qu’il n’y a pas lieu de s’interroger sur les intentions que peut avoir un poète lorsqu’il produit un poème : « Ce que Saint-Pol-Roux a voulu dire, soyez certain qu’il l’a dit. »
Tout cela est bien beau, pensera-t-on, mais en quoi cela concerne-t-il l’ouvrage de Tristan Malavoy ? C’est que, ma foi, il y a chez ce poète un fort beau mélange de la maîtrise du langage à la Valéry — c’est son côté fête de l’intellect — et du surréalisme dans ses eaux les plus vives — une certaine faillite de l’intellect se rencontre également chez Malavoy, l’intellect étant dans ses poèmes quelque peu relégué dans l’ombre, et ce, à la faveur de ce que la nuit en viendra à déposer dans ses mains. Ce cadeau empoisonné que lui fera la nuit, parfois il cherchera à le décrypter, parfois il préférera plonger son regard dans les « images d’un trou noir supermassif » et il attendra patiemment « devant l’écran, comme on guette l’aube, plutôt que de relire les décombres de [la] nuit. » Il y a chez Malavoy, me semble-t-il, une double posture : elle consiste en un effort visant à saisir le sens évanescent de l’aventure que vivre implique et en une ouverture de l’esprit, si l’on peut dire, qui consiste à accepter de contempler sans parvenir à le décrypter le déroulement de cette grande aventure qui nous entraîne au-delà de toute forme de contrôle que l’on puisse tenter d’exercer sur elle.
Dans un autre ordre d’idées, les poèmes de Malavoy font montre d’une réelle maîtrise du langage. Dès le premier poème, mesure et précision du discours sont manifestes. Nous avons affaire non pas à de la haute voltige, encore moins à de la poudre aux yeux langagière ou à de l’éloquence, mais à une évidente qualité d’écriture, laquelle se maintient tout au long du recueil. En cela, il y a fête de l’intellect dans le sens donné à cette expression par Valéry. Or cette intelligence a également trait au propos, lequel se précise moyennant la collaboration du lecteur, c’est-à-dire son consentement à travailler le discours à son tour, à se servir à sa guise, comme le dit Valéry, de l’appareil poétique mis à sa disposition par le poète.
Prenons à titre d’exemple le premier texte du recueil.
La membrane luit dans le matin, ses nervures nouées comme ton histoire. Elle s’est détachée sans que tu t’en aperçoives. La lumière joue dedans comme dans un instrument désaccordé.
À première vue, si l’on se contente de survoler ce poème, autant dire qu’on ne sait pas trop ce qu’il peut bien signifier. Mais dès que l’on passe au poème suivant, on est en mesure de faire des liens, que dis-je ? Non pas de faire des liens, mais bien plutôt de constater que le poète file quelque chose. Il aura beau écrire plus loin que la « pensée n’a plus rien d’un fil », il n’en pense pas moins. Dans son recueil, il développe des pensées, il fait des observations, commente l’aventure dans laquelle vivre l’a plongé, le plonge et le plongera. On sera d’autant plus réceptif à ce texte liminaire que, dès avant lui, avec le titre et surtout les exergues, l’auteur aura pris soin de nous fournir des clefs.
Le premier exergue emprunte à la poète Denise Desaultels. Malavoy cite un extrait du Saut de l’ange : « Un jour la scène devint noire. Aujourd’hui j’entre / dans mes rêves, sans aucune protection contre / les mots qui aboient dans le sommeil et / s’imposent avec une implacable clarté. » (Je respecte le découpage de l’exergue, j’ignore s’il est fidèle ou non à la disposition originale du texte chez Desaultels.) Les mots de la poète éclairent à coup sûr le travail de Malavoy, sinon, évidemment, il ne les aurait pas utilisés. Force est de constater qu’ils l’éclairent en effet, puisque le recueil nous conduira dans un univers souvent proche du rêve — c’est l’aspect surréaliste du texte de Malavoy, lequel texte cependant ne peut être aucunement confondu avec la logorrhée qui parfois caractérise la poésie surréaliste, celle notamment où il est recouru à l’écriture automatique. Par ailleurs, certains passages du recueil sont à rapprocher du type d’image préconisée naguère par les surréalistes.
« La scène devint noire », écrit Desaultels, aussi noire pouvons-nous dire que la nuit apparaissant dès le titre du recueil de Malavoy. Si les mots chez ce dernier ne semblent cependant pas aboyer, nous pouvons croire qu’ils se manifestent dans le sommeil de la nuit du poète, et que ce sommeil, métaphorique peut-être, a lieu durant une nuit sans doute tout aussi métaphorique. Il est dit chez Desaultels que ces mots « s’imposent avec une implacable clarté ». Dans ce qu’il a créé, celui que Valéry appelle le « constructeur » peut saisir cette clarté. Mais il y a fort à parier que le lecteur la percevra à sa manière. C’est dire qu’entrer dans un recueil comme celui de Malavoy, c’est un peu accepter que la scène devienne noire, ne serait-ce que momentanément, et en sachant que les mots ressembleront à ceux qui « aboient dans le sommeil ». Nous serons aveuglés pendant un certain temps, mais, comme l’indique le second exergue, emprunté cette fois au Roland Giguère des Armes blanches, à tout le moins discernerons-nous quelque chose : « vois comme je te vois moi qui / pourtant ferme les yeux ».
Nous fermons les yeux, la nuit alors est noire ; viennent le rêve, ses mots, puis à la fin arrive ce constat : « je te vois », je vois du sens, je fais des liens. J’avance. Le poète avance grâce à chacun de ses poèmes. Il est engagé dans une aventure et nous, lecteurs, le sommes à sa suite : « Tu avances en terre brûlée. Ton chant se ramifie, s’encrypte. »
Le premier poème est court. Je le reproduis à nouveau. « La membrane luit dans le matin, ses nervures nouées comme ton histoire. Elle s’est détachée sans que tu t’en aperçoives. La lumière joue dedans comme dans un instrument désaccordé. » Après la nuit, où l’on ne voit rien, sinon le noir, le sens progressivement se manifeste tandis que peu à peu l’aube se précise. Il est écrit que « la membrane luit ». De quelle membrane s’agit-il ? Puisqu’avec Giguère, il a été question des yeux, on pourrait croire que le poète parle ici de la membrane de l’œil, mais rien n’est moins sûr. Est-ce bien elle, cette membrane, ou plutôt est-ce « ton histoire » qui « s’est détachée sans que tu t’en aperçoives » ? Puis, énigmatique et fortement évocatrice, cette dernière phrase : « La lumière joue dedans comme dans un instrument désaccordé. » On croirait ici décrit le symptôme d’une affection de l’œil. Et si cette membrane était à la fois celle de l’œil et celle que l’on verra dans le poème suivant, je veux parler de la peau que laissera la couleuvre derrière elle ? Et si cette peau était celle de ce « tu » auquel s’adresse le poète ? Alors, il serait question tout au long de ce recueil de son parcours, de sa trajectoire de vie, de son histoire. Ainsi, dans les dernières pages du recueil, s’étonnerait-on pas de retrouver cette couleuvre : « Au réveil il n’y a plus de murs ni de plafond, qu’un ciel agrégat où s’attardent des pourquoi. Quelle couleuvre l’a avalée ? Est-ce que c’était l’été dernier ou bien un siècle avant ? La première neige tombe sur ton piano et c’est son rire que tu entends. » Le mot « avalée » s’accorde-t-il ici avec la neige ? Je crois plutôt qu’on trouvera son antécédent dans le poème précédent. On y voit une église de craie. La couleuvre l’aura avalée.
Le lecteur croira que les poèmes de Malavoy sont terriblement complexes, il aura tort et raison à la fois. Qu’il les lise en privilégiant la fête intellectuelle ou au contraire sa faillite, autrement dit qu’il cherche à dénouer « ses nervures nouées comme ton histoire » ou qu’il s’abandonne à la féerie savoureuse d’un langage on ne peut plus onirique, faillissant alors à en saisir les arcanes, lors même qu’il serait sans doute insensé de tenter de les percer à jour, le lecteur joue ici à qui perd gagne : il gagne le plaisir en perdant le sens, il perd la dimension ludique des poèmes en gagnant sur eux un surcroît de compréhension.
Je ne veux ici entreprendre plus avant un commentaire descriptif des poèmes de Malavoy. La tâche, quoique plaisante, nous retiendrait trop longuement. Je voudrais néanmoins faire valoir qu’à mon sens chacun trouvera son intérêt dans la lecture de ce recueil. On aimera lire des poèmes qui se suivent de manière rigoureuse tout en entretenant entre eux des liens parfois ne tenant que par un fil, ténu, ou que l’on ressent ainsi, et que l’on risque parfois de ne pas même saisir. Dans le domaine du rêve, certaines réalités échappent à nos sens, à notre compréhension. Il en va de même avec les poèmes de Malavoy. À condition de les lire lentement et d’y revenir pour se les approprier et en apprécier davantage la beauté, l’on entreprendra grâce à eux une aventure moins déroutante qu’il n’y paraît de prime abord.
On lit vers la fin du recueil une phrase qui pourrait sonner comme un désaveu : « C’est un poème que tu attendais mais ce ne sont que des mots qui arrivent. » Pour ma part, je n’adresserais pas un tel reproche à Malavoy. Avec ce dernier recueil, il ne nous impose pas « des mots orgiaques et désordonnés enfilés à des hasards au cou de fée. » Son recueil a beau être déconcertant par endroits, sa matière et sa manière sont riches à souhait.
Légendes à rabais, secrets de Polichinelle et chansons perdues. Tu t’agenouilles au milieu de ce pauvre inventaire, nu et incertain de ce que la nuit déposera dans tes mains.

C’est fou comme ta patience et ton entrain, ta détermination à bien lire et ton engouement devrais-je dire, nous donnent envie de fouler le chemin à ta suite, de saisir les poèmes de Malavoy, lentement, pour aller en vérifier l’éclat et le mystère. Merci Daniel. Si j’entre dans une librairie, je saurai quoi feuilleter et choisir…
J’aimeJ’aime
Et toi, mon ami, tu es patient de bien vouloir lire mes « petites études ». Le Malavoy est certes un bon recueil, mais j’en ai lu un récemment d’un poète québécois dont le nom malheureusement m’échappe. Toi qui as lu tous nos poètes, peut-être saurais-tu éclairer ma lanterne. Si je me souviens bien le titre du recueil est quelque chose dans le genre « Lettres d’écorce ». Amicalement !
J’aimeJ’aime
«…le lecteur joue ici à qui perd gagne : il gagne le plaisir en perdant le sens, il perd la dimension ludique des poèmes en gagnant sur eux un surcroît de compréhension.»
Génial! Fallait y penser.
La poésie pousse le lecteur à jouer avec les perspectives comme un acrobate du Cirque du Soleil!
Seul un Maître peut nous révéler ces astuces!
J’aimeJ’aime
Maître est un bien grand mot. Il va sans dire que les « acrobaties » très discrètes de Malavoy n’ont rien de gratuit. Le mot « prétérition » est lui aussi un grand mot. Salut !
J’aimeJ’aime