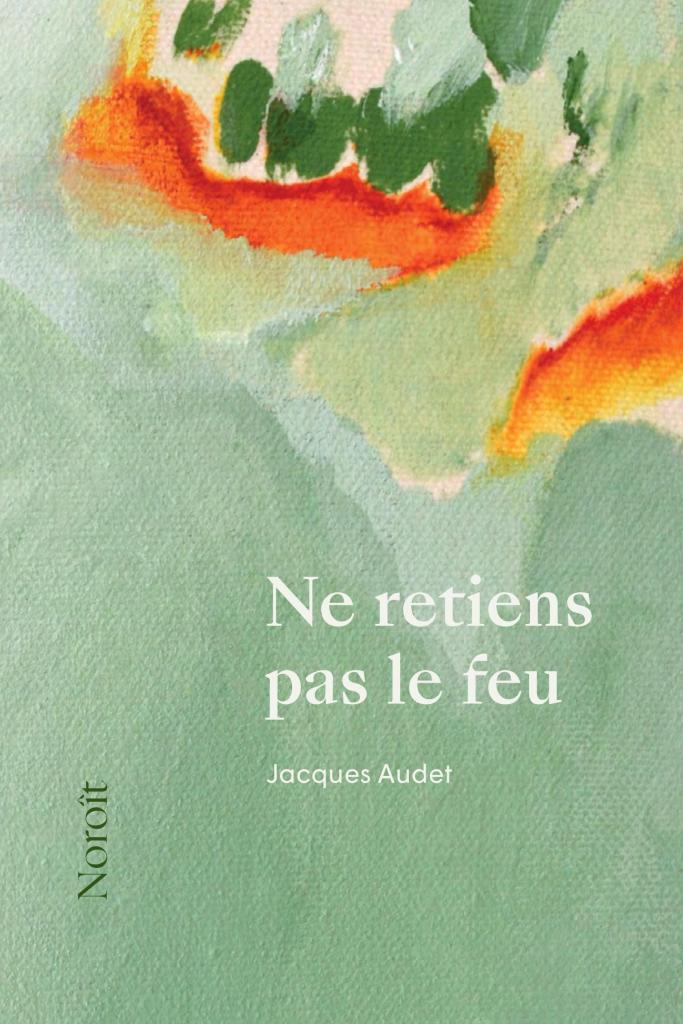
Il y aurait beaucoup à dire au sujet de ce petit livre. Il contient des poèmes dont on ne saisit pas immédiatement ce qu’ils disent et dont, même lorsque nous l’avons lu et relu, beaucoup reste à saisir une fois interrompue la série de relectures que nécessairement il appelle.
Ce livre est minimaliste par au moins deux de ses aspects, le premier étant relatif à la forme de ses poèmes, le second, au peu de sens que l’on en retient lorsqu’on les lit d’abord sans vraiment les lire.
L’aspect formel confère au recueil, ne serait-ce que sur le plan visuel, une grande unité. Qui le parcourt en tournant les pages les unes après les autres constate immédiatement que les poèmes se succèdent en occupant dans la page un même volume ; ils sont tous de dimensions à peu près égales, ne comptant jamais vraiment plus de dix vers, lesquels sont brefs, et dont aucun jamais ne se rejette à la ligne suivante. Les 5 sections du recueil contiennent un nombre variable de poèmes, entre 5 et un peu plus de 20 pour un total d’environ soixante poèmes. L’ensemble totalise un peu plus, un peu moins de 2 400 mots. En ce sens, on peut dire que le recueil va vraiment à l’essentiel.
Ce qui renforce l’impression, évidemment fausse, que l’on a d’être en présence de peu de substance tient au laconisme de ces poèmes. Le poète est peu bavard. Il pose, je l’ai déjà évoqué, peu de mots sur une même page. Or ces mots forment tout de même des phrases. On croirait à tort que cela va de soi. Il est des poètes qui accolent des mots sans forcément les relier entre eux, dont les énoncés consistent quasiment en des énumérations, des juxtapositions de termes qui se suivent sans s’enchaîner les uns aux autres. Jacques Audet pratique un dépouillement moins radical en cela que ses propos s’inscrivent dans des énoncés qu’ordonne une syntaxe fidèle aux règles de la grammaire. Mais pour autant, si la logique est structurelle, les liaisons où se nouent et se dénouent les mots font fi d’une logique de sens telle qu’elle se rencontre dans le logos universel, lequel n’est pas toujours de l’ordre du bavardage, surtout pas dans ce recueil. Les significations du discours banal de nos échanges quotidiens, lorsqu’il est question de la pluie et du beau temps, ne posent aucun problème de compréhension. On y dit et entend les mots de tous les jours. Or ce sont précisément ces mots que l’on rencontre dans Ne retiens pas le feu. Des mots simples, justement comme le mot pluie, le mot temps, ainsi que d’autres tout aussi usuels : feu, nuit, silence, mésange, etc. Ces mots n’ont rien du concept. Pourtant dans le recueil, tout en référant à ce que d’ordinaire ils désignent, les voici comme frappés de silence. Un voile d’abstraction les recouvre dont la lecture les libérera ou non, selon que lecteurs et lectrices consentiront ou non à s’investir dans leur lecture. Me reviennent en mémoire les propos suivants de France Cayouette. « Selon moi, on ne doit pas essayer de comprendre la poésie, mais plutôt la recevoir avec nos sens, notre intuition et avec abandon. Ça prend de la lenteur, de la solitude et du retrait pour entrer dans le territoire du poème, où la rencontre peut avoir lieu. »
En maints passages du recueil, je me plais à m’abandonner aux beautés des poèmes de Jacques Audet, à rencontrer le dire du poète et le poète lui-même dans le territoire que celui-ci met à notre disposition. Pourtant, je perçois sous la couche des mots, sous la surface du sol de ce territoire, un magma de sens et de feu qu’il n’est pas interdit d’appréhender par le biais de l’analyse, d’une lecture où l’intellect a aussi ses mots à découvrir, interpréter et dire.
Le poète a dit ce qu’il a dit. On pourrait répéter ce qu’écrivit Breton au sujet de Saint-Pol-Roux : « Ce que Saint-Pol-Roux a voulu dire, soyez certain qu’il l’a dit. » Mais encore. Certains poètes, ne faisant pas le pari de la limpidité, n’ont justement pas à le tenir. Même de très abordables peuvent donner du fil à retordre au lecteur. Ce qui n’empêche en rien d’admirer leurs poèmes. À propos d’un poème qu’il trouve « mystérieusement beau », un poème de Saint-Denys Garneau, Melançon déclare : « Je l’ai lu je ne sais combien de fois, sans jamais tout à fait comprendre ce dont il est question, néanmoins en pressentant que s’y cache quelque chose qui importe, qu’une vérité s’y offre et fuit à la fois. On lit aussi des poèmes pour se mesurer à une énigme dont on ne viendra pas à bout. »
Je ne tenterai pas de venir à bout des énigmes contenues dans le recueil d’Audet, du reste, ce ne sont pas véritablement des énigmes. Des fils çà et là sont disséminés dans le texte, ils permettent à tout le moins de raccommoder du sens. Fils ou clés interprétatives, comme on voudra. Il faut se rattacher à quelque chose d’autre que ce à quoi réfèrent les mots, pris isolément ou même en groupe, car s’il y a des phrases, celles-ci n’opèrent pas « normalement », en respectant une manière de faire, même usitée pour ne pas dire répandue dans la plupart des poèmes qui se publient ici ou ailleurs. Car, il faut le mentioner, quantité de poètes optent pour la ligne claire, pour une quasi-transparence du sens. À tout le moins, avec la plupart des ouvrages poétiques il est assez aisé de cerner le propos, encore davantage le référent.
Le titre fournit habituellement quelque indice. En milieu de lecture, on est à même de vérifier sa pertinence ou non, à même de profiter des lumières qu’il jette sur l’ouvrage. Les rapports qu’il entretient avec le texte nous apparaissent alors clairement ou plus ou moins obscurément. Dans certains cas, le titre n’entretient que de vagues rapports avec l’ouvrage, par exemple lorsqu’il est emprunté à un passage plus ou moins représentatif de l’ouvrage. Dans le cas présent, nous possédons le feu et l’idée qui voudrait qu’il ne faille point tenter de le retenir. À quoi s’ajoute l’injonction de l’impératif. Quelqu’un conseille ou ordonne quelque chose à quelqu’un d’autre, quelqu’un d’autre s’il ne s’agit pas ici d’un discours à soi-même adressé. Il arrive, en effet, comme on sait que dans les recueils, le poète soliloque comme pour soi seul, qu’il s’entretienne avec son propre esprit, avec sa conscience.
Le titre, on le voit, permet d’avancer dans notre lecture. Il introduit la présence du feu de même qu’un renoncement à intervenir dans l’aventure qui est sienne. Le feu « est », il faut le laisser être. Cela le recueil le confirmera.
Mais si le recueil n’était pas ainsi intitulé ; si en lieu et place, nous substituions à son titre un vers du recueil, mettons : « Tout redevient possible » ou « Le ciel s’est creusé sous tes pieds », qu’en serait-il alors de ce feu ? Nous lui prêterions sans doute moins attention. Les autres titres influeraient à leur manière sur notre lecture. L’orienteraient-elles pour autant fort différemment ? Je crois que non. Pour pertinent que soit le titre choisi par Audet, il n’est qu’un fil parmi d’autres. D’autres fils conducteurs innervent notre lecture. Et ils sont nécessaires et bienvenus. Ce sont les exergues et les titres des différentes parties du recueil ; ce sont surtout les poèmes eux-mêmes qui « parlent », je ne prétendrai pas le contraire, bien que ces derniers, par leur concision et le choix que fait l’auteur de l’ellipse, exigent une importante collaboration du lecteur pour se faire entendre. Si ces divers poèmes donnent, nous devons nous rendre disponibles à accueillir ce qu’ils offrent.
Déjà nous voici avancés dans notre lecture. Nous savons grâce au titre qu’un sujet, s’adressant à un tiers ou à lui-même, recommande ou ordonne de ne pas chercher à retenir le feu. Quel feu ? Est-ce un vrai feu, du genre qui brûle et dévaste des contrées entières comme le font les incendies de forêt ? Est-ce un feu imaginaire ? Un feu symbolique ? Avec ce feu, y a-t-il ici une métaphore ? La filera-t-on de manière allégorique ? Cela reste à voir.
Rabattons-nous pour l’instant sur les exergues. Ils ne sont pas empruntés aux premiers venus, mais à Paul Celan et Hölderlin, des poètes qu’on ne prend jamais à la légère. Ces derniers expriment et communiquent de la substance. On ne les accuse ordinairement pas d’être hermétiques, notre incompréhension si certains de leurs poèmes nous résistent ne semble reposer à nos yeux que sur notre propre indigence de lecteur. Par le choix de ces auteurs, le poète semble s’inscrire dans une lignée, s’avancer sur un territoire peu commun, celui d’une poésie de la pensée. Certes, la philosophie dans leur cas ne s’organise pas en système, elle fonctionne peut-être par « bonds » de l’esprit. Le mot revient chez Audet. Il apparaît dès le premier poème de son recueil : « tes bras se chargent/de bruits avant le bond ». Ils se chargeraient de fruits, nous serions moins dépaysés, davantage sur le territoire des vergers que sur celui du verbe. Car, oui, c’est bel et bien du verbe qu’il s’agit, celui du commencement, du milieu et de la fin. C’est le langage. On trouvera de nombreux passages dans ces 62 poèmes où il est question de mots, de langue. Mais revenons aux exergues de Celan et d’Hölderlin. Le premier, en tête du recueil, se lit comme suit : « D’une clé qui change/tu ouvres la maison/où tournoie la neige des choses tues ». Le second, ouvre la première partie du recueil : « L’esprit erre de haut en bas ».
Dans un cas comme dans l’autre, voilà des mots qui résonnent dans le recueil. Ils sont particulièrement bien choisis. Tout comme l’on peut s’arrêter aux vers du recueil afin de longuement les méditer, les paroles des deux poètes allemands s’avèrent porteuses de sens et leur résonnance dans le recueil mérite d’être soulignée.
Bien entendu la traduction est malvenue, celle à tout le moins du genre que méprisait Breton lorsqu’il déclarait que Saint-Paul-Roux par « mamelle de cristal » n’avait pas voulu dire « carafe », et qu’il fallait donc prendre ces mots tels quels, sans leur chercher des équivalents dans notre petite prose rationnelle, celle qui aplanit le verbe poétique, celle qui annule son territoire. Oui, je sais, il y a les limites inhérentes à ce type de « traduction », néanmoins, rien n’interdit de chercher à comprendre, car l’apanage de la poésie n’est pas forcément d’imposer de l’incompréhension. L’idée qui anime un poète ou une poète, l’intention à l’origine de leur intervention dans le langage n’est pas de produire quelque « inanité sonore », j’emprunte à Mallarmé, inanité réfractaire à toute saisie de l’esprit.
Je retiendrai donc des paroles de Celan les métamorphoses de la clé. Celles-ci s’accompagnent des métamorphoses de l’esprit. Nous n’ouvrons jamais la porte de la maison du poème avec la même clé, puisque celle-ci varie sans cesse. Par ailleurs, dans cette maison « tournoie la neige des choses tues » que le poète s’évertuera à faire émerger de leur silence. Au-delà de la beauté si riche de l’image de Celan, portée par celle-ci, nous éclaire une certaine vérité. Elle n’est pas claire comme du cristal, mais cette voix lactée, si l’on me permet de recourir moi-même à une métaphore, fait tout de même entendre quelque chose. Au risque d’offenser le fantôme de Breton, j’avancerai que les paroles de Celan, altérées dans la voix d’Audet, se déploient sous mes yeux de manière à signifier, pourquoi pas ? que dans Ne retiens pas le feu tournoie également « la neige des choses tues ». Bref, le poète accordera au non-dit assez d’importance pour chercher à pénétrer dans cette maison, celle du poème et de sa propre conscience, en se servant du langage, clé changeante s’il en est une.
Puis, d’Hölderlin, nous retiendrons, semblable aux variations de la clé, semblable également à la neige dont le flottement et le vol sont aléatoires, variables, que l’esprit monte et descend, en un va-et-vient lui-même erratique. Tel est le cheminement, une trajectoire aussi imprévisible que les mouvements de la flamme dans le brasier. L’esprit du poème danse ainsi. On ne s’étonnera pas dans ces conditions d’avoir à adapter notre esprit à cette danse, d’avoir à user d’une clé interprétative assez souple pour entrer dans la danse et valser avec les flocons de neige que sont les mots du poème, la neige et le feu n’étant pas forcément antinomiques lorsqu’il s’agit des choses communes au poème et à l’esprit.
Nous sommes encore au seuil, sur le pas de la porte. Nous n’avons fait que l’entrouvrir. Nous n’avons pas encore pénétré entièrement dans la maison des poèmes de Jacques Audet. J’ai cependant laissé entendre que ses poèmes sont riches de sens, que si dans un premier temps leur référent est loin d’être évident, des clés peu à peu en viennent à s’offrir à nous à travers chaque poème du recueil. C’est que notre imagination se met progressivement en marche, en état de réceptivité, nos pas en venant à tomber dans ceux du personnage qu’interpelle le poète, un autre lui-même semble-t-il, intériorisé, celui de sa conscience : « tombent tes pas/sur un sentier de sel ». Comme en un rêve pourtant fidèle à la réalité, rêve dont le miroir déformant la reforme, le poète nomme en image le paysage que nous traversons, pas à pas, paysage de notre existence. Mais ne nous emportons pas ; même si les images du poème engendrent en nous de nouvelles images, soyons plus sages. Il convient de s’en tenir à ce qu’écrit le poète.
On assiste en lisant ses vers au déploiement d’une pensée qui s’élabore dans le mot à mot de mots se répercutant les uns sur les autres, à la manière de l’écho, comme fonctionnent les rimes dans leur engendrement ou ici, plus exactement, les homophones, paronymes et autres mots partageant des sonorités voisines, ou des couleurs, des rapports sémantiques — toutes les propriétés du langage conjuguant leurs efforts afin de parvenir à du sens que d’abord l’on n’a perçu que vaguement, il est vrai. Le sens de ces poèmes tremble comme vacille la flamme du feu qu’il ne faut pas retenir.
En l’absence du titre, je me répète en extrapolant, je serais cependant curieux de voir comment nous lirions ce recueil. Un titre ouvre un champ de vision tout en le restreignant, offre un champ d’interprétations possibles. On parcourt le recueil en cherchant la propagation de ses flammes dans les poèmes. Chaque fois qu’on rencontre un mot appartenant aux champs sémantique et lexical du mot feu, on acquiesce, on applaudit le poète jugeant qu’il manifeste alors de la suite dans ses idées. Tout cela est bien, mais ne dispense pas de lire vraiment, lire signifiant ici relire. Un poème, du genre qu’écrit Audet, appelle sa relecture, gagne à être amplement fréquenté. Même les lecteurs et lectrices de poèmes aguerris, de guerre lasse, délaissent parfois un ouvrage qui dans l’immédiat leur échappe. On aurait tort de faire subir un sort semblable aux poèmes de Jacques Audet. Son livre est loin d’être volumineux, mais chaque mot y fait tournoyer une neige et des flammes qui n’en finissent pas de danser.
Pour ma part, j’y trouve mille et une beautés, ce n’est pas peu dire pour un ouvrage comptant si peu de mots. Ces beautés sont bien évidemment de langage, mais elles sont également relatives au propos. Car, oui, bien que je ne l’aie pas encore identifié, il y a bel et bien ici un propos. Une histoire est racontée de manière fragmentée. Une posture éthique s’élabore. C’est dire que les pas tombés « sur un sentier de sel » ne tournent pas en rond, ne font pas du sur-place. Cette posture éthique se manifeste à travers les rares injonctions que portent les impératifs, le premier rencontré ayant trait à ce feu qu’il ne faut pas chercher à retenir, et d’autres, rares, explicites ou non : « ne plante pas le glaive », puis, ayant déclaré qu’« il est massif le cœur de cœur de l’instant », le poète (se) recommande d’être sensible à la réalité de cet instant (« tu happes hier et demain/avant de les brûler/pour retenir la grâce » : la grâce étant celle qu’offre le présent de la présence à soi et au monde). Il lui conseil de se montrer attentif aux incidences que l’instant a lui-même : « entends qu’il te dégage/de toute prise ». Plus loin, encore une autre recommandation : « attends que retombent les images ». Ces citations, extraites de leur contexte, paraîtront bien sibyllines. En détachant du texte les citations, on les ampute toujours d’une grande partie de leurs significations. C’est là un dommage collatéral. On aura compris que j’avais à cœur de révéler grâce à elles la part d’éthique à l’œuvre dans les poèmes d’Audet. C’est qu’on n’use pas du mode impératif autrement qu’à partir d’un point de vue que l’on cherche à partager ou imposer dans certains cas. Point de vue, vision du monde.
Je parlais d’une histoire, j’aurais dû dire plutôt une trajectoire. Je ne veux pas trop m’y attarder, mais j’évoque à nouveau ce « sentier de sel ». Il apparaît dans le poème liminaire. Poème que je trouve aussi riche de sens que les autres du recueil. Ce premier court poème se termine ainsi : « pour toi voici/la table rase/un escalier debout ». Si avec le sentier, le poète ira de l’avant (« droit devant s’ouvre un visage »), avec cet escalier, assurément il gagnera en hauteur, ne serait-ce que parce qu’il sera lui-même parvenu à se tenir debout. En ce redressement de l’être correspondent sans doute le programme du recueil et son ultime réalisation. Il y a donc ici une courbe narrative, l’amorce d’une entreprise (faire table rase, gravir un escalier), suivi d’un travail sur soi (qui consiste peut-être à habiter le cœur de l’instant, à faire le tri dans ses émotions et ses idées) et, se prolongeant dans un accomplissement, il y a enfin une résolution : « Le jour maintenant/desserre son enclave », « s’ouvre dans la forêt/une clairière/où ton regard/se met à nu ». Telle est l’histoire que relate ce recueil. Histoire de délivrance, de libération (« la nuit se libère de ses chaînes »).
On n’entre pas dans ce recueil comme dans un moulin. On en sort cependant avec regret, ayant noué avec lui des liens que je dirais d’amitié. On le referme en espérant que le poète, dont le précédent et tout premier recueil parut en 2009, ne mettra pas une éternité avant de nous proposer son troisième livre de poésie.
Une image après l’autre
tu allèges le jour
de ses fardeaux
rejettes le nom
inutile de la peur
soigneusement ficelés
tes morts reposent
leurs pieds tournés vers l’est
cet amas d’yeux de lèvres
éclipse le silence
où ton esprit reflue

Merci, c’est un plaisir de suivre vos découvertes poétiques. Je vais l’ajouter sur ma liste 🙂
J’aimeJ’aime
Je vous souhaite du bon temps. On doit lire ce livre lentement, y revenir, relire souvent chaque poème. Lentement. Et alors, ça y est, le déclic se fait.
J’aimeAimé par 1 personne
Merci pour ce judicieux conseil !
J’aimeJ’aime
Te suivre dans ta traque systématique de la beauté d’un recueil de poèmes est en soi-même aussi passionnant pour moi qu’une aventure de l’incroyable Indiana Jones!
«Poésie de la pensée; …car l’apanage de la poésie n’est pas forcément d’imposer de l’incompréhension; …l’esprit du poème danse ainsi; …le sens de ces poèmes tremble comme vacille la flamme du feu qu’il ne faut pas retenir». Etc.
Comment ne pas tomber sous le charme du recueil de Jacques Audet à la lecture de telles étincelles!
J’aimeJ’aime
Merci encore, Laurent, de prendre le temps de lire mes « petites études » et de m’en dire du bien. Tout cela m’encourage à poursuivre mes travaux.
J’aimeJ’aime