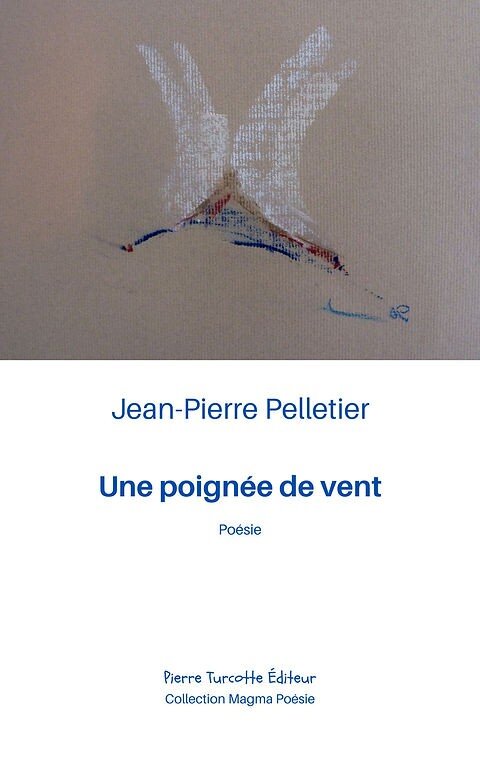
Ce poète regarde le monde et le contemple afin d’en souligner à la fois les désastres et la beauté. Au centre de son tableau, il inscrit celui qu’il appelle « l’humain » ; il montre ce dernier dans un univers dévasté, une sorte de désert, un blanc, un vide absolu. C’est là un symbole. Il brosse le portrait d’un homme en marche, d’un pèlerin. Devant lui, au bout de sa route sont des villes nouvelles à découvrir et la mer, surtout la mer, le vaste océan où joue le vent et dont les vagues se gonflent.
Lisant ce recueil, je ne puis m’empêcher de penser à l’œuvre de Saint-John Perse. Non parce que la prosodie de Pelletier s’en rapprocherait, ce qui n’est pas tout à fait le cas, mais en raison de la hauteur et de l’ampleur de son propos. Aussi parce que du début à la fin, le registre littéraire se déploie avec une certaine magnificence. Le caractère épique de la poésie de ces deux poètes est ce qui dans mon esprit les unit. On trouve chez l’un et l’autre une entreprise, une quête, une aventure collective. Certes, Perse ressemble à un oiseau de grande envergure volant lourdement et persévérant longtemps au-dessus des vastes territoires que parcourt, explore et conquière sa parole. La force des éléments naturels semble se retrouver au cœur de sa poésie, laquelle rivalise quasiment par sa haute tenue avec les vents et la mer. Au sol, sur la grève, il crée d’immenses blocs de paroles d’où son poème s’élève jusqu’aux plus hauts sommets, aux étoiles quasiment de la pensée et du sentiment. Un souffle incommensurable alimente sa forge.
Pelletier, lui, ne donne pas dans le monumental, dans le symphonique, dans les stratosphères. Il semble cependant nous offrir des fragments dont la tonalité est souvent similaire à celle des poésies de Perse, à la différence que chez lui le verbe ne s’accomplit pas à travers de vastes déploiements. Comme mentionné ci-haut, la prosodie chez ces deux poètes diffère considérablement. Aux longs versets qu’affectionne Perse, notre poète privilégie une forme plus concise. Ses poèmes, que sur la page de titre il prend soin d’appeler des prosèmes, ne sont pas versifiés, même librement ; ils n’empruntent nullement aux divers procédés de la versification, ne sont en rien construits systématiquement dans le constant souci des accents de rythme, dans l’alternance des sonorités, comme en une danse rappelant celle des longues et des brèves, ou plutôt d’assonances et allitérations prononcées et divers procédés se trouvant chez les Anciens, que Perse, tout moderne qu’il fût, parvint admirablement à ressusciter, chez lesquels en tout cas il puisa, et dont nos contemporains et moi-même, du moins pour la plupart, ignorons à peu près tout. Il y a belle lurette que le vers à peu près partout a été chassé de la poésie.
Chez Pelletier, donc, nous ne trouvons rien qui s’apparentent à de fastueuses constructions, nul recours aux grandes figures d’une rhétorique parfois ronflante, avec ses périodes emphatiques, non, mais de manière plus retenue, notre poète produit des morceaux qu’on croirait prélevés à même de gros blocs de discours, tels ceux que pratiquait Saint-John Perse, et alors ce ne sont pas à de grandiloquentes épopées que nous avons affaire, mais, ici et là, à « un bout d’épopée », quelque chose non pas comme le puissant aquilon qui souffle dans les versets du poète de Vents, mais bien plutôt une poésie générant des paroles semées en « une poignée de vent ».
Ce rapprochement, sur lequel je ne m’éterniserai pas, faute de pouvoir le mener à bien, avec preuves à l’appui, permet néanmoins de cerner une des particularités de la poésie de Jean-Pierre Pelletier, à savoir son caractère universel. Ce n’est pas à sa propre subjectivité que le poète nous convie, c’est à une collectivité, à un projet collectif, à une marche commune. Il y eut autrefois l’impassibilité parnassienne, le poète étant de glace, son poème empruntant à la dureté du marbre. Ce n’est pas le cas ici. Le verbe de Pelletier est vraiment habité par une âme, un sujet y manifeste de la pensée. Et c’est avec chaleur qu’il entreprend d’ajuster ses mots à notre monde, de recourir au langage pour mieux situer l’humain au cœur du désert.
Mais par désert, qu’entendons-nous précisément ? Je ne saurais répondre à cette question, et du reste le poète lui-même ne s’engage pas dans ses prosèmes à préciser nettement sa pensée et encore moins ses états d’âme, quoiqu’on les puisse aisément deviner —on le sent profondément inquiet. Non, rien ici qui soit de l’ordre de l’intime. Nous n’apprendrons rien sur le sujet Pelletier en lisant sa Poignée de vent. L’intime, du moins dans ces pages, ne l’inspire pas. Il ne se confesse pas, ne nous offre pas un autoportrait. Non, je le répète, il s’intéresse au sort du plus grand nombre. Devant le présent dévasté, devant le futur incertain, le poète manifeste de graves préoccupations. Son « je » est absent dans la première partie de son recueil. Le poète écrit au « nous ».
Que dit-il de nous ?
Cela est du plus grand intérêt. L’auteur nous parle de notre aventure sur Terre, sur cette planète dont il ne répétera pas ad nauseam qu’elle est sur le point de voler en éclats, toutefois, c’est là une vérité qui se trouve en toile de fond dans son recueil et qu’il évoque sans jamais s’appesantir sur tous les malheurs qui nous accablent, malheurs qui ne sont pas uniquement d’ordre politique et social, qui sont aussi et peut-être surtout d’ordre métaphysique ; or tout cela est inextricablement relié. L’humain qu’il faut sauver est lui-même responsable de sa destinée. Nous voici lancés depuis l’aube de l’humanité dans une aventure qui aujourd’hui plus que jamais sans doute se heurte à des impasses. Du moins, tel est le constat du premier prosème :
Tout fuit, se délite, gagné par la fumée, le souffle et les choses sans forme autour desquelles nous gravitons, Les mots comme les gens courent au plus pressé puis s’effacent dans leur blancheur.
Je l’avoue, cet effacement dans la blancheur m’a longuement laissé songeur. Et admiratif. C’est là un blanc hautement significatif. L’auteur a trouvé le mot juste. Son blanc est celui de l’effacement, d’un certain retour à la page blanche de l’histoire de la Terre et de l’humanité. Nos discours — ils seront plus loin dévalorisés par le poète qui accusera leur inanité : « Se taire devient ce langage dont le vent porte très haut la connaissance et le respect. » — nos discours, dis-je, courent comme les poules sans tête que nous sommes. Les gens sont pressés. Nous sommes pressés. Puis, inéluctablement viendra notre effacement dans la blancheur. Notre disparition est en latence. Imminente.
Imminente, mais le poète tout de même ne se fait pas alarmiste, pas tout à fait ; il reste peut-être un certain espoir, qu’une page çà et là recèle, que l’ensemble du recueil assurément exprime. Le « passeur », un des « personnages » du recueil, cherche une issue afin d’échapper au délitement général. Aucune piste cependant ne lui apparaît dans le labyrinthe des cartes qu’il consulte. En l’absence des dieux, l’humain en est réduit à naviguer à l’aveugle, dans le blanc total d’une absence de sens, de direction indiquée, de directive. La nature cependant vient rappeler au poète que quelque chose en l’absence de l’homme, soit le monde tel qu’il sera ou aura été avant lui, amputé donc de sa présence, que ce monde au naturel recèle tout de même un caractère sacré, et à tout le moins connaît et manifeste une manière d’harmonie, voire d’absolu : « Nous disposons d’une patrie que nous avons peuplée par inadvertance. Les arbres, les montagnes, un étang nous incitent à l’indulgence. Nous existons peut-être par défaut. » Telle est aujourd’hui notre pauvre patrie, qu’il eût mieux valu habiter poétiquement. Ce vœu hölderlinien est fort pieu, trop sans doute pour ceux que plus loin dans son recueil le poète appellera les bourreaux et autres « prêcheurs sans envergure ».
Le poète file dans son recueil la métaphore de la marche, de la pérégrination. Le passeur est celui qui favorise le passage d’un ici à un ailleurs. Il salue bellement « les voyageurs qui se libèrent de leurs pas. »
À la première partie du recueil, écrite au « nous », fait suite celle que le poète intitule « Des images dérobées ». Cette fois, il s’adresse à un « tu » qui est « le descendant des convoyeurs de rêves » bien que ce « tu ne rêves plus. » Devant lui se trouve « l’étendue incertaine ». D’autres départs sont à venir :
Si tu t’engages dans une terre d’exil, ou dans une voie plus délicate, continue de restituer au monde ses élans d’une jeunesse foisonnante. Il y aura toujours quelque messager aussi noir que le soleil pour t’escorter vers le terme du parcours : // tu le remercieras d’une poignée de vent.
Ce recueil brillamment conçu contient trois parties. Après celle du « nous » vient la seconde où le poète parle au « tu » avant de donner dans la troisième la parole à un « je » qui affirme que « Tout n’est pas perdu ».
Ainsi, même par-delà « une cathédrale déserte » et même si « les pigeons ne nichent plus sur les gargouilles », le poète ne désespère pas. Il considère que tout n’est pas perdu.
« C’est cette parole qui vient d’appareiller aux quatre vents du lendemain. »

Daniel,
Ce rapprochement avec Saint-John Perse, tu n’es pas le premier à l’avoir évoqué. Mais tu as fait les nuances qui s’imposent, me semble-t-il.
Mes lectures d’Alexis Léger remontent à ma prime jeunesse.
Je te remercie de cette lecture sensible, attentive d’Une poignée de vent.
Mes salutations les plus senties,
Iohannes Petrus
J’aimeJ’aime