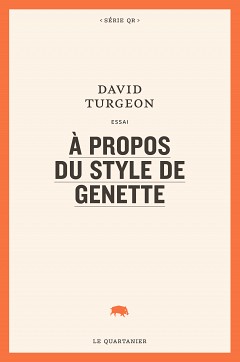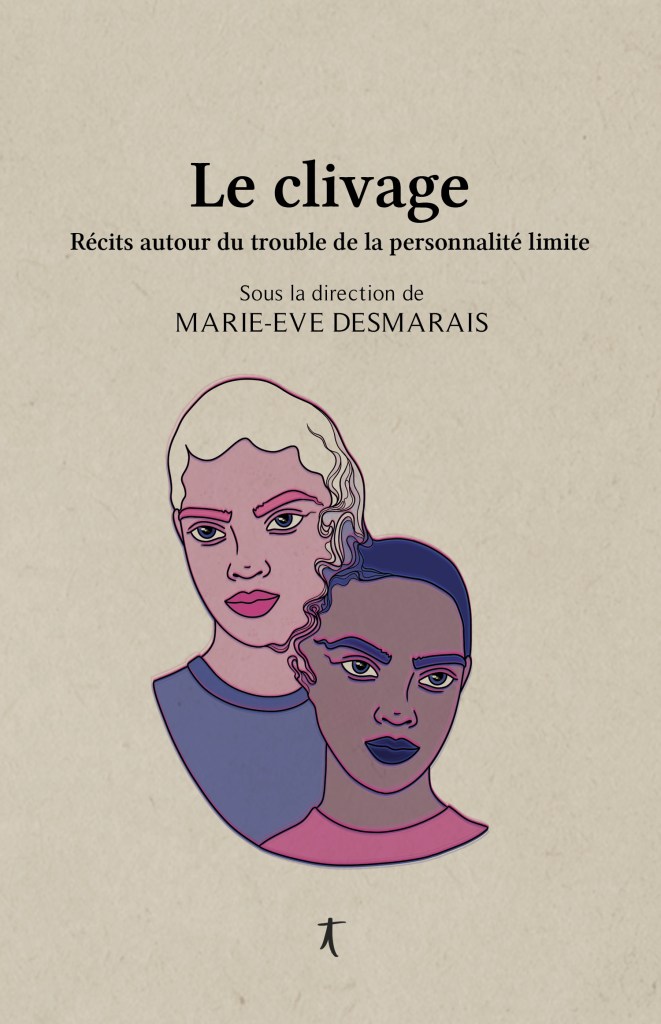
« C’est la même histoire qui se répète. » Cette phrase est extraite de l’introduction. Marie-Ève Desmarais en est l’autrice. Elle l’intitule INTRODUCTION / TOUTES CELLES QUE JE SUIS. Le statut de son texte est particulier, syntone à l’ensemble des récits que nous lirons, marqué déjà par l’idée du clivage donnant son titre à l’ouvrage, la « personnalité limite » étant caractérisée non par une simple dualité, mais bien plutôt par une multiplicité pourrait-on dire de personnalités, par des identités plurielles, tel que le laisse entendre le sous-titre : TOUTES CELLES QUE JE SUIS.
Une préface conventionnelle serait plutôt froide, distante, présentant de manière objective, de manière factuelle la forme et le contenu d’un ouvrage, les circonstances l’ayant vu naître, ses visées, etc. Rien de tel ici, l’autrice saute plutôt à pieds joints, in medias res, dans les eaux troubles où s’aventureront à sa suite les autres auteurs et autrices. Bref, dès l’ouverture, nous plongeons en pleine littérature, en pleine folie dans l’univers trouble qui sera exploré, mais exploré de l’intérieur et non pas de manière clinique ou « scientifique ». Ce ne sont pas des psychologues qui nous « apprendrons » ici ce qu’est la personnalité limite, mais des hommes, des femmes et d’autres souvent issus de communautés aux identités autres, du type LGBTQ2SIA+. Ils écriront en puisant dans leur propre réalité (qu’est-ce que la réalité ?), dans leurs propres phantasmes, dans leur imaginaire, comme on dit, dans leur vécu.
« C’est la même histoire qui se répète. » Ces mots de Marie-Ève Desmarais correspondent également aux témoignages des autres écrivains et écrivaines rassemblés dans ce collectif. Leurs histoires ont plus d’un trait en commun. Si bien que le sous-titre de l’introduction peut s’entendre, pour peu qu’on tende l’oreille à tout ce que crient et murmurent les différents textes ici réunis, comme émanant justement de cet ensemble, à savoir que ce que je suis, c’est non seulement une personne aux identités multiples, mais l’ensemble des personnes ici réunies. Autrement dit, en introduction, et parce que c’est la même histoire qui se répète, Marie-Ève Desmarais résume les différents parcours de tous les « je » qui après elle ajouteront au sien leur propre témoignage. J’ai eu cette pensée, qui ne tient pas tout à fait la route, lorsqu’après avoir lu l’entièreté du livre je suis revenu à l’introduction. Il m’a semblé alors que ce que racontait son autrice révélait ou contenait en germe tout ce qui par la suite se déployait dans ce petit ouvrage. Bref, son « je » me semblait englober les autres « je » du collectif, lequel est du reste caractérisé par une grande unité (de pluralité et de diversité). Cette impression était si forte que, voulant la mettre à l’épreuve, j’ai relu à nouveau les neuf autres textes du recueil. J’ai constaté ce faisant que Marie-Ève Desmarais n’avait pas systématiquement entrepris de synthétiser morceau par morceau l’ensemble des récits de Clivage. Néanmoins, en substance, les liens entre les textes étant si nombreux, son premier texte joue fort bien son rôle d’introduction. Il ouvre aux thèmes qui seront abordés. En voici quelques-uns. Il traite du vide (« rien ne satisfait le vide) ; du vertige ressenti aux abords du gouffre (« Avide d’une véritable chute ») ; des déceptions engendrées par les amours qui tournent court (« Je veux me rhabiller de toutes les fois où j’ai été déshabillée ») ; du recours à l’exacto (« coupure par-dessus coupure ») ; du travail à réaliser sur soi afin peut-être de cesser d’être tant d’autres (« Je ne sais pas qui je suis au moment de me reconstruire »). On y voit des perles comme c’est le cas dans la plupart des autres textes, on y voit ce qu’on appelle curieusement des « bonheurs d’écriture », curieux bonheurs alors que règnent au sein de ces textes le chaos et la souffrance. Bonheurs d’écriture rappelant que l’ouvrage s’inscrit et s’écrit en pleine littérature. Par exemple, Marie-Ève Desmarais écrit : « Je cassais toujours les bijoux de perles, inconsciemment ou consciemment, je laissais tomber un brin de sainteté du même coup. Sans trop attendre, je me suis débarrassée des perles, j’ai compris la plus-value des chaînes. J’ai voulu m’attacher moi, attacher les autres, nous attacher, m’attacher aux objets, empêcher tout le monde et toute chose de me quitter. »
Après avoir livré son propre témoignage, en lequel témoignage, comme ce sera le cas avec les autres, la part de fiction demeure indéterminée (où commence et où s’arrête le « mentir-vrai » ?), la préfacière se fait préfacière en toute conformité avec les us et coutumes régissant le genre : elle rompt avec le ton personnel, avec son histoire personnelle, pour présenter de manière plus académique la suite des choses : « Les textes qui composent ce livre sont des portraits de nous, qui portons la folie. Parfois avec douceur, violence ou tristesse, ces portraits sont notre façon de nous réapproprier notre histoire : celle de notre trouble de la personnalité limite. »
À la limite, une personne porte un nom qui en quelque sorte la porte, auquel nom, sa personne s’identifie, est identifiée. Chez les écrivains et écrivaines, le nom d’origine ou si l’on veut, mais autre temps, autres mœurs, le nom de baptême se trouve conforme davantage à ce que l’on fut que ce que l’on souhaite devenir. Qui donc voudrait être et demeurer ad vitam aeternam un simple Gérard Labrunie ? un quelconque Henri Beyle ? un anonyme Eugène Grindel ? une Donnadieu quand on a perdu la foi ? La personne de l’écrivain et de l’écrivaine aspire à plus grande personnalité, au statut de personnage historique ou du roman. On sera Gérard de Nerval, Stendhal, Éluard ou Marguerite Duras ou l’on ne sera rien. On se révélera en se cachant derrière un pseudonyme. Pour parler de ses dérives, on devient Annie K. Pour témoigner de ses crises, on choisit un nom sans majuscule : lexplosiv. Lux Fé écrit EXISTENCE-SANS-CONTOUR. Zêta nous rappelle que N’EST PAS FOU QUI VEUT. Patrice se contente d’un prénom pour explorer LA LIMITE. Ces manières de s’identifier publiquement sont sans doute révélatrices d’un rapport à l’existence où est recherchée la préservation d’un soi que l’on ne veut révéler qu’en se tenant derrière le miroir de la dissimulation ou de la simulation. Mais avec ou sans pseudonyme, nous sommes ici en terrain de pure littérature. Le pire, ou le plus cruel ici, est que de littérature il n’est question qu’en passant. Je veux dire que s’il est donné à ces dix écrivain(e)s d’avoir recours à l’écriture pour se chercher, se perdre et peut-être se trouver, ce qui les anime, ce qui les détruit ne caractérise pas que leur seule existence, mais bien celles de tous ceux et celles dont ils sont ici en quelque sorte les porte-paroles, ce qui donne à ce collectif une valeur extralittéraire ou, corrigeons-nous, une valeur pleinement littéraire dans la mesure où la littérature est justement affaire de partages et de rencontres.
Pour cette dernière raison s’évapore ici le malaise éprouvé plus haut à parler de bonheurs d’écriture. Ramener à la littérature les souffrances ressassées par les dix textes de ce volume me paraissait faire injure à leurs auteurs et autrices. C’était faire fi d’une évidence, à savoir que si la littérature n’est pas leur planche de salut, elle est en tout cas ce à quoi ils recourent pour vivre et exprimer leur souffrance. Tous les hommes et toutes les femmes de lettres ne sont pas aux prises avec les démons de la folie, tant s’en faut, n’empêche, qu’on écrive ou non, dans la mesure où tous et toutes vivent, tous et toutes, hommes et femmes du commun, frôlent plus ou moins dangereusement les limites de la personnalité limite. Évidemment, pas au point où en sont « réduits » les auteurs et autrices de ce collectif. Vraiment, il faut avoir un cœur de pierre pour ne pas être touché par leurs récits. J’ai évoqué le premier récit. J’esquisse maintenant ce qu’offrent les suivants.
Julien Guy-Béland propose un récit où sont nuancés les mérites de l’abstinence en matière d’alcool et de drogues. Le titre : TOXIC : BABY DONT YOU KNOW THAT YOUY’RE. Puisque, pour citer à nouveau Marie-Ève Desmarais, « [c’] est la même histoire qui se répète », des troubles anxieux conduiront le narrateur en thérapie, on lui prescrira du citalopram, il sera ou aura été étudiant en littérature à l’université, y fréquentant des ateliers de création littéraire. Son texte se termine par un constat qui donne à réfléchir : « Il se peut qu’à la longue, je ne sois plus sobre, et ce ne sera pas nécessairement un échec, tout comme ce que je vis en ce moment a peu à voir avec la réussite. »
Zêta, dont la notice nous apprend qu’il est « [o]riginaire de nulle part », prendra pour parvenir « là » où il se trouve à la fin de son récit, c’est-à-dire, dans « un espace mental » où « [il peut] agir selon [sa] volonté », un chemin jalonné de nombreux cabinets de psys. Ce récit est l’un des plus longs du recueil. La notice indique qu’il est « plein d’ironie ». Pour ma part, je le trouve plutôt troublant et drôlement bien mené. N’EST PAS FOU QUI VEUT est son titre.
Avec EXISTENCE-SANS-CONTOURS, Lux Fé propose trois poèmes. La notice nous renseigne à son sujet. Iel est « un.e artiste pluridisciplinaire (peinture, poésie et danse) ainsi qu’un.e militant.e pour plusieurs causes sociales. » Ses poèmes rejoignent les thèmes récurrents du recueil, dont celui du vide : « ‘‘ Ce vide est plein de quelque chose’’ me dit-elle ». Il s’agit pour iel de trouver les mots qui « trouveront les chaînes qui rendent chaque instant / Insuffisant ». On s’étonnera peut-être d’un langage poétique où le registre familier et le discours savant s’amalgament, où « Déconstruire le cadre épistémologique » côtoie « Les battements de mon cœur ». Puis, « Entre névrose et psychose », après qu’il ait été question entre autres choses d’« une mère qui n’est pas capable de calmer son enfant », une question est posée : « A-t-on le droit d’aimer quand on est borderline ? » J’ai pris un peu de temps pour rechercher sans succès dans le dictionnaire le sens du mot « timé ». Peine perdue, il fallait plutôt comprendre, bien que le mot ne soit pas en italique, qu’il s’agissait d’un mot anglais. Lux Fé habite l’Amérique du Nord, comme tant d’autres il n’hésite pas à recourir à la langue anglaise ; dans son cas, la « Souffrance-jouissance / Quasiment timée / Chaque année, […] arrive ».
SYMPTOMATIQUE est le plus long récit du recueil. Il est signé Azucena Pelland. De toute évidence, cette autrice n’a pas perdu son temps lors de ses études universitaires. Elle est titulaire d’une maîtrise de création. Dans son cas, le mot maîtrise est on ne peut plus justifié. Sans tenir compte du contexte, j’extrais de son récit la citation suivante afin de l’appliquer à cette écrivaine : « Il y a des diamants qui brillent même dans le noir. » Oui, tout est bien sombre dans ce récit, comme dans les autres où le rire se fait rare, tout est sombre, mais la plume d’Azucena Pelland sait tirer parti du chaos et de la douleur. On trouve un grand nombre de bonheurs d’expression dans ce texte portant sur la toxicomanie : « Il est six heures du matin, tu es assise dans ton salon avec un étranger, de tout petits sacs en plastique sur la table et l’opéra cruel des oiseaux étouffé par le double vitrage. » Ici encore il est question d’automutilation, de crises de panique. La pratique du jeûne permet plus ou moins de « disparaître ». On se montrera attentif aux notions d’enfant-écran et d’enfant-éponge. Vraiment, ce texte ne peut laisser indifférent.
Archie S. Reid est un artiste transdisciplinaire. À ses images se mêlent ou se superposent de brefs poèmes. Sur une de ses photographies, le visage d’une jeune femme se voit dédoublé ; elle fixe l’objectif, puis s’en détourne. L’absence d’expression sur ce visage en dit long sur l’état d’esprit de la jeune femme. On retrouve ici le vide qui traverse le recueil de part en part : « Et devant le vide ». Le clivage se donne à lire dans les mots que voici : « J’ai eu peur d’être passé à côté de / Moi-même / De mes hantises ». On retrouve à peu de choses près le constat résigné sur lequel se terminait le texte de Jean Guy-Béland, l’échec et la réussite étant ramenés sur le même plan, revenant au même. On lit dans INVISIBLE : « Et je ne fais plus la différence / Entre l’or et le pus / Les deux me font peur ».
MES DÉRIVES est la première publication d’Annie K. Écrits entre 2009 et 2021, les poèmes de cette suite font eux aussi part de « cicatrices » et le vide se manifeste pleinement au cœur de l’être : « le vide en moi se creuse / prend de l’ampleur ». J’en ai glissé un mot alors que je rendais compte de la présentation de Marie-Ève Desmarais. Il m’avait semblé que celle-ci, avec « toutes celles que je suis », tant les souffrances de qui s’assemblent ici se ressemblent, avait dans son introduction rassemblé les propos de ceux et celles qui dans ce petit livre prennent la parole. Dans le vide qui les hante tous et toutes, l’écho des paroles de chacun chacune se répercute de texte en texte. C’est ainsi que dans les poèmes d’Annie K. l’on retrouve la figure de la prostituée qu’évoquait au tout début de sa préface celle qui écrivait : « J’ai l’identité fragmentée. J’incarne la vierge, la putain et toutes celles qu’on me reproche d’avoir été. ». Au désir de s’annihiler de l’une répond celui qu’a l’autre de fuir, de disparaître :« désirant l’exil de ma personne / plus que tout au monde ».
Il a beau être court, mené en seulement deux pages et demie, le récit MES CRISES est on ne peut plus percutant. Ses qualités littéraires méritent d’être soulignées. L’autrice, dont je rappelle que le pseudonyme est lexplosiv, tout comme plusieurs des auteurs et autrices du collectif, a étudié en création littéraire. Au point où nous en sommes dans notre lecture, après avoir parcouru plus du trois quarts du livre, nous sommes en terrain de connaissance, ce qui ne signifie pas, bien entendu, que le récit de lexplosiv soit superfétatoire. En ajoutant au dossier, il en corrobore la pertinence. Les autres avant elle ont abordé la question du vide, qui est moins une question qu’un abîme. Explosiv l’évoque à son tour : « l’immense vide que je ressens en permanence. » La mère de la narratrice est infirmière, elle prend elle-même des anxiolytiques. Elle est convaincue que pour sa fille s’impose pareil traitement. C’est avec ses mots que débute le récit : « Tu n’auras pas le choix, ma fille, tu dois absolument être médicamentée. » La fréquentation d’une kyrielle d’hommes au fil des ans ne lui apportera ni bonheur ni apaisement. Le manque est toujours flagrant, qui semble inéluctable : « Les années ont passé et les espaces vides se sont tranquillement fossilisés dans mon ventre. Ils sont tellement nombreux que, maintenant, tout est sur le point de s’effondrer. Peu importe avec qui j’essaie de partager ma vie, il me manque quelque chose. »
Patrice propose avec LA LIMITE un autre beau récit. Beau, pour toutes sortes de raison dont la principale est peut-être la légère note d’espoir sur laquelle il se termine. L’auteur s’identifie comme un iel. Le narrateur de son récit est une femme : « On m’a traitée de girouette, de bébé, de bipolaire, de malade mentale, de folle, de sans-personnalité. » Elle a des « émotions en montagnes russes », est aux prises avec « un problème d’intensité. » Sans surprise, mais en se sentant à nouveau interpellé par le phénomène, on renoue avec le vide, qui se présente ici comme « le Grand Vide ». « J’étais un marin qui tentait de s’accrocher à quelque chose, un bout de bois, pour ne pas se noyer, mais dont les mains ne rencontraient que de l’eau. Je me noyais dans le Grand Vide. » L’exacto refait son apparition. De même que la colère. Des spécialistes des troubles anxieux sont consultés ici aussi. Elle fréquente un atelier littéraire. La professeure demande comme premier texte la rédaction d’un autoportrait. « Elle voulait connaître notre intérieur, notre univers personnel, ce qui nous habitait. » Cela ne se fera pas facilement, mais cela se fera.
ONZE. Alice Rivard rédige le texte qui clôt l’ensemble. Il porte sur la souffrance, ici portée à son paroxysme. À cette souffrance correspond une colère qui prend elle aussi des proportionnées, non pas démesurées, mais en phase avec sa souffrance paroxystique. Un leitmotiv traverse ce récit. Il s’agit d’une question : « Sur dix, la douleur est à combien, zéro étant aucune et dix étant insupportable ? » À quoi invariablement il sera répondu « Onze. Onze, crisse, onze. » On connaît la chanson, mais ce n’est justement pas une chanson, au pire, un air d’opéra, quand, au pire, invariablement et toujours, succède le pire. Souffrance, thérapie, amours qui ne riment à rien. À la fin, mais non sans colère, une lueur d’espoir, un vœu.
À la question :
Combien valez-vous sur dix, zéro étant rien, dix étant du pure fucking gold ?
J’aimerais vraiment ça un jour pouvoir répondre.
Onze. Onze, crisse, onze.

Les auteurs et autrices de ce collectif bouleversant n’hésitent pas à pratiquer une forme d’écriture visant à transformer le monde grâce entre autres à une réforme de l’orthographe. En traitant des différents sujets qui les préoccupent, ici les troubles de la personnalité limite, ils marquent dans leur propos un propos second, sous-jacent. Dire qu’ils courent deux lièvres à la fois n’est pas leur faire injure. Au cœur des mots qu’ils écrivent « autrement », ils tiennent manifestement à poursuivre un combat qu’ils jugent essentiel. Qui pourrait leur donner tort ? Jusqu’où les suivra-t-on dans leur pratique langagière ? L’avenir le dira.