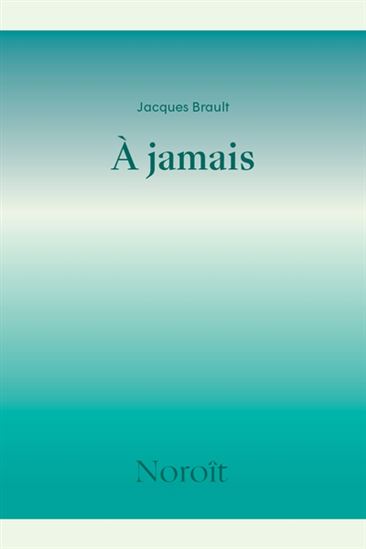L’auteure s’est attelée à une tâche complexe. Il s’est agi pour elle de plonger dans ses archives, de revenir sur ses pas, de se remémorer ses passages au fil des ans en diverses villes, pour enfin parvenir à une langue, à une ligne d’arrivée où rien pour elle ne saurait s’arrêter, d’où les choses enfin commencent, pourrait-on dire, à pleinement signifier. Car de tout temps, le projet ici est d’être, de devenir à part entière soi-même, fidèle à ses désirs et ses choix.
Pour dire et poursuivre son parcours, l’auteure trouve des mots si justes, les dépose de manière si réfléchie dans ses carnets, qu’on craint de déformer ses idées sitôt qu’on les aura extraites de leur contexte afin de les faire passer de sa langue à la nôtre.
Disons-le d’emblée, cet ouvrage est exigeant. Il n’offre rien qui soit de l’ordre d’un divertissement. En cela, il se conforme à l’attitude de la voyageuse qu’aura été Carole Forget durant ses nombreux séjours à l’étranger. Elle ne s’est pas rendue ailleurs pour s’étourdir en ces vains plaisirs qu’offrent les attractions touristiques. Elle ne le mentionne pas ou alors seulement le manifeste entre les lignes : pour elle, voyager n’entretient aucun rapport avec les divertissements. Le voyage pour physique qu’il soit est d’abord et avant tout voyage intérieur. Il est ici question d’une quête. La poète s’interroge sur ce qu’est partir, sur ce que signifie revenir.
Qu’ont à nous dire les lieux que nous hantons ? Que nous hantons d’abord là où se situe notre lieu premier, car nous y percevons que le monde ne s’arrête pas au seuil de notre maison familiale, mais qu’il y commence une fois nos valises faites et la porte enfin ouverte pour partir de chez soi à la recherche de cela que précisément nous ignorons, et qui nous dira enfin, peut-être, sans doute, dans ce qui se réfléchira sous nos yeux, à travers ce que ces autres réalités du monde nous révéleront.
Qu’ont à nous dire ces lieux que nous découvrons enfin dans les pages des livres ? Les livres que les vagues de l’histoire ont déversés sur nos rivages, nous venant de France et de Navarre, des quatre coins du monde, ne nous montrent-ils pas eux aussi ces ailleurs où quelque chose s’est passé et se passe encore ? Tandis que chez soi, il n’y a rien de tel, rien dans son coin de pays, souvent une banlieue, fade et moderne. Il s’agit d’un lieu sans âme. Je cite Mallarmé, un extrait de son « Coup de dés » : « RIEN […] N’AURA EU LIEU […] QUE LE LIEU ». Donc, rien n’aura eu lieu avant que les maisons en rang y aient été érigées, formant des quartiers sans histoire autre que celle, inconnue, — ou reléguée aux oubliettes — des premiers habitants du vaste territoire américain dont on les a chassés. Carole Forget ne mentionne pas nos autochtones, mais elle réfère souvent à une terre qui a comme histoire surtout celle de sa géologie. Comment, au milieu de ce qui apparaît ici comme un désert culturel, une âme curieuse et sensible n’éprouverait-elle pas devant les richesses dont regorgent les villes anciennes, celles de la vieille Europe surtout, de forts désirs d’ailleurs, dont on pourrait dire qu’ils relèvent chez elle d’un certain bovarysme intellectuel ? On a découvert dans les livres les merveilles des mille et une villes du monde et l’on se contenterait de s’enterrer vivant dans les déserts de son propre petit Yonville ? Non, décidément, il faut partir, partir à la découverte du vaste monde et y découvrir, peut-être surtout, à quelles possibles réalisations de soi y donner libre cours.
Comment ne pas trahir un tel livre ? Ou plutôt, comment le présenter en occultant le moins possible les méandres tous plus significatifs les uns que les autres de la pensée qui le traverse ? Ce livre est un essai, qui plus est un essai poétique. On le sait, il n’est pas d’essai sans exercice de la pensée. La pensée en soi est exigeante. On me pardonnera ces truismes, mais j’insiste. Il importe de présenter un ouvrage en disant ce qu’il est. Pour ce faire, pour peu que l’on éprouve quelque difficulté à accomplir cet exercice, on peut tenter de mentionner ce qu’il n’est pas. Je le ferai d’abord, puis tenterai de coller le plus objectivement possible à l’objet qu’est Langue d’arrivée.
L’essai de Carole Forget n’est pas un ouvrage de vulgarisation. Il ne porte pas sur un sujet « évident ». Le sous-titre manifeste clairement le projet de l’auteure. Il sera question des lieux, de la langue et du rapport liant l’une aux autres. Ah ! se dira-t-on, cela ressemblera à une étude portant sur la langue parlée, disons le français, tel qu’il se déploie sur les territoires québécois, français et ceux de divers pays de la francophonie. Eh bien, non. L’enquête ici n’est pas de nature ethnolinguistique. Elle est plutôt philosophique. On parle à son sujet d’un essai poétique. Voilà qui risque de brouiller les pistes. La plupart se font de la poésie une idée qui confine ses propos au vague des mots et des idées. Un essai poétique ne nous apprendra rien en clair si tant est que poème est le discours qui, par définition, s’en tient à un mélange de flou avec de l’encore plus flou. Telle n’est pas mon idée, mais, en général, c’est à peu près ce qui est véhiculé à propos de la poésie. Or voilà, que cela soit dit une fois pour toutes, la plume de Carole Forget, pour poétique qu’elle soit, et parvenant en certains passages à franchement nous éblouir, cherche véritablement à faire de la lumière, la poète ne se complaisant pas dans l’obscur afin de se montrer plus brillante qu’elle ne l’est. Non, si sa phrase peut donner du fil à retordre, c’est que l’auteure tente de dénouer à la fois les réalités et les rêves, à la fois ses sentiments et ses idées. Et c’est donc en poète qu’elle s’y prend. Mais attention ! Il est une autre idée que l’on associe spontanément à celle de la poésie, c’est celle du lyrisme. Or voilà, ce texte est plutôt exempt de lyrisme. Le « je » est relativement peu employé bien que l’auteure conduise de fort près une analyse de ses rapports personnels et intimes avec les villes où elle a longuement séjourné. Mais de la même manière qu’elle reste discrète sur sa personne, gardant le silence sur la nature de ses émois, de ses détresses, les lieux jamais ne sont vraiment décrits dans ses carnets. Nous n’aurons pas d’informations à leur sujet. Leur emplacement demeure vaguement esquissé, ils ne sont pas situés, pas nommés. La poète donne les raisons de cette abstention, de ce clair-obscur nominatif qui les nimbe. C’est afin de les restituer dans leur pure présence. Plus de précision atténuerait ou annulerait la transfusion de sens qu’elle en a reçue. Les lieux donc ne sont pas nommés.
Je disais procéder par la voie négative, cherchant à préciser ce que n’est pas la poésie de ces carnets. J’ajouterai une quasi-absence d’images, comparaisons, métaphores, allégories et autres figures de ressemblance. Les mots et les phrases pourtant ne défilent pas sans « écriture ». En eux repose une poésie que l’on pourrait dire textuelle, que personnellement j’associe à un certain formalisme. Ce souci de forme, de construction, de rigueur va de pair avec le projet de l’auteure. Il s’agit, puisqu’elle rédige un essai, de travailler le sentiment, l’histoire de sa venue progressive au monde grâce à ses pérégrinations, en élaborant idée après idée une analyse des liens unissant, je le rappelle, les lieux où elle séjourne à une langue à laquelle elle désire accéder. Parler ici d’une forme hybride, sous prétexte que ce livre est un essai poétique, ne serait donc en rien pertinent. Ce le serait si la poésie de Carole Forget participait de ce genre de poèmes auxquels on consent tout naturellement une pluralité de sens, comme leur étant inhérente, dont on apprécie la beauté ou la musicalité sans trop se soucier de ce qu’ils peuvent communiquer, étant entendu que les poèmes sont davantage affaire d’expression « artistique » que de communication.
Si le lecteur devant certains passages de ces carnets peut s’interroger, ce n’est pas en raison de l’usage qu’il y est fait des mots, mais plutôt en raison de la nature des idées que développe l’auteure. Sa pensée est complexe et pour l’exprimer elle choisit un mode d’écriture que je désigne volontiers sous ces termes de poésie textuelle, en référence à l’extrême raffinement d’un travail formel accompli sur le matériau langagier. Le traitement en est hautement littéraire, l’esthétique étant mise au service des incursions que l’auteure mène dans l’investigation de ses rapports aux villes, aux langues de départ et d’arrivée. En tout, il serait juste d’affirmer que, comme dans tout essai, il est ici question de comprendre quelque chose, d’appréhender par la pensée un phénomène, celui, ici, qui conduisit la poète à quitter son pays natal, à se dépayser, à s’étranger ailleurs, pour enfin parvenir à la vraie réalité de sa personne. Rimbaud parlait de la « vraie vie », à laquelle la tradition a abouté une autre citation du jeune poète, à savoir que la vraie vie est ailleurs et parfois même « absente ». Pour se rendre présente à sa vraie vie, la poète a dû s’exiler. Le terme d’exil n’est peut-être pas juste, mais partir fut nécessaire afin de parvenir un jour à sa langue d’arrivée.
Je dois ici tout reprendre du début, par souci de clarté, bien que je sache qu’il serait vain de chercher à faire tenir en de simples énoncés l’ensemble des recherches et des interrogations encloses dans les pages de ces carnets.
Langue d’arrivée est constituée de cinq carnets. L’intitulé de chacun commence par le mot « carnet » : Carnet de retour, Carnet en zone franche, Carnet des temps manquants, Carnet de dépôt, Carnet de la visiteuse. Ces sections sont suivies de notes situant quelque vingt citations éparses dans le volume provenant d’auteurs connus pour l’intérêt que représentent leurs idées, leurs travaux philosophiques ou littéraires. Aucun de ces auteurs n’est un auteur léger. Ce sont des poids lourds de l’écriture et de la pensée, je veux dire de grands intellectuels. Ces citations en disent long sur la teneur des écrits de Carole Forget.
Après ces notes vient un mot de l’auteure. Son commentaire fait en quelque sorte le point sur ses carnets. Il en fournit la genèse que voici. La poète en commença la rédaction, la rumination, parallèlement à un ouvrage de poésie intitulé Langue de départ. En marge de ses poèmes, l’écrivaine rédigeait des notes « plus réflexives, plus spéculatives ». Elle explique que la « prose réflexive de Langue d’arrivée a été motivée par l’exigence d’approfondir non pas un parcours, mais les retombées de celui-ci, ses conséquences. »
Dans « La musique et les lettres », Mallarmé écrit ce qui suit : « Tout voyage se passe après, en esprit, il vaut, par recherche ou comparaison, quand on est de retour. » Voilà qui présente de manière on ne peut plus juste la démarche entreprise par Carole Forget dans ses carnets. Ce sera lors de son arrivée, à son retour, que la poète accédera enfin à sa langue, c’est-à-dire, si j’ai bien compris, à cela même qui résume toute son âme, à savoir une parole qui soit véritablement sienne, en laquelle coïncident là où elle se trouve son propre corps, son discours, enfin sa personne tout entière. Par infusion de tous ses ailleurs en son être, par l’entremise de toutes les villes où elle aura habité, la poète sera enfin parvenue à naître, à être pleinement.
Tout cela peut paraître fort abstrait, et ce l’est en partie, mais ce l’est uniquement afin d’advenir à cela qu’il y a de plus concret, cela l’est par nécessité, car il faut en passer par la pensée afin de parvenir à ce bouquet de soi qui est en soi la réunion de tout cela que l’on a été, là où l’on a été, puis ici où l’on arrive enfin. Abstrait ? Non, pas tout à fait.
Premiers mots de l’ouvrage. Ils sont à vrai dire immédiatement saisissables : « Je suis de retour au pays de ma naissance. » Et puis, sur cette première page, est mise au clair de la nature du projet, de son pourquoi : « comprendre l’ici, où je suis ».
Le voyage commence par après, c’est dire qu’une fois de retour il se prolonge : « mon parcours se poursuit, je suis en marche. » La poète est précisément en quête d’une « définition de [sa] propre présence. » J’ai évoqué plus haut ce que j’ai appelé un bovarysme intellectuel, il a trait à une insatisfaction de nature culturelle. Forget écrit : « Trop peu de pierres narratives pour construire nos liens avec la maison. » Les pierres de la maison neuve et natale ne racontent nulle histoire. « Ce territoire nord-américain s’est structuré en quartiers d’abondance », qui se taisent pourrait-on dire. Il faudra alors trouver une langue de départ : « il m’est possible d’élaborer mon départ, quitter ma ville, me vider d’un silence. » Carole Forget devra inventer sa propre langue afin d’en venir à faire parler un jour les pierres de sa propre maison, maison créée de toutes pièces qu’elle transportera partout avec elle, ainsi que la tortue porte son domicile sur son dos. « Une insuffisance m’a menée hors du logis premier — auquel je n’ai concédé que ce titre, point de départ. »
L’auteure parle d’un « transfert de soi à soi ». C’est par la découverte des nouveaux espaces que ce transfert s’est opéré dans son cas. On aura compris que la visée de sa démarche, la raison de ses déplacements aura concerné « l’avènement de soi ». Voyager, pour elle, ç’aura été naître en ses propres termes, selon ses propres choix, dans une langue forgée à même la découverte des villes nouvelles. Elle écrit : « Élaborer ma genèse inouïe ». En parfait accord avec la pensée de Mallarmé, on lit ceci dans Langue d’arrivée : « Une genèse qui s’écrit invariablement à la fin, lorsque le parcours peut être jaugé par une vue d’ensemble. »
Je m’en voudrais de terminer ce commentaire sans mentionner qu’outre l’intérêt suscité par les réflexions de la poète, réflexions sur lesquelles je n’aurai fait somme toute que lever un tout léger voile, les pages offertes par Carole Forget possèdent d’indéniables qualités littéraires. La beauté ainsi qu’une grande maîtrise s’y montrent partout souveraines.